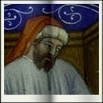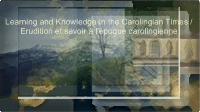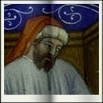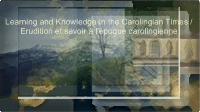
 .La Maison de la Sagesse de Bagdad .La pensée juive
.La Maison de la Sagesse de Bagdad .La pensée juive 
La philosophie
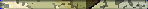
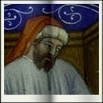 | Boèce enseignant; manuscrit italien du XIVème siècle |
La philosophie, jusqu'à l'avènement du catholicisme, avec les mythes et les religions, a entrepris de répondre aux questions fondamentales que l'homme se pose sur sa vie, la mort, l'Univers, le monde qui l'entoure. Le catholicisme apporte une réponse d'autorité définitive à tout cela. En découle toute une attitude vis-à-vis des possibilités des chrétiens de continuer de s'interroger
De l'Inde à la Patristique
C'est surtout le monde occidental et indo-européen (Inde et Grèce) qui ont développé la réflexion philosophique alors que celle-ci tient une place moins importante chez les peuples du Moyen-Orient y compris dans le monde arabe. L'Inde, d'abord a développé un solide système de conception du monde fondée sur l'idée d'un être unique à l'origine de tous les phénomènes de la vie, accompagné de tout un corpus de métaphysique, cosmologie, psychologie et éthique. Le bouddhisme, qui est un pessimisme, ne naît qu'à partir de l'hindouisme et, en Chine, se combinera au taoïsme et au confucianisme. Les philosophes grecs, ensuite, sont passés d'une première réflexion sur l'état du monde (la stabilité, le changement...) à un questionnement sur l'homme (morale, l'idéalisme de Platon -les idées abstraites des humains sont un reflet d'un monde supérieur, Aristote -qui pense que toute perception vient des sens de l'homme) puis à diverses écoles morales (les Stoïciens, par exemple). La philosophie grecque s'achève, enfin, par les néo-platoniciens d'Alexandrie, au début de l'ère chrétienne, qui développent un mysticisme à tendances astrologiques. Pour ce qui de la philosophie, l'attitude de l'Eglise s'organise sur le fait que les Pères de l'Eglise, quoique marqués par leur environnement néo-platonicien, s'en sont démarqués par l'idée qu'il y a une Création et que les êtres possèdent leur identité puis que St Augustin fusionne intellectualisme et mysticisme néo-platonicien (et que le néo-platonicisme, adapté au catholicisme, est perpétué, au Vème siècle, par le pseudo-Denis). La chrétienté byzantine et orientale ne produisent que peu de philosophie
La grande question des "universaux"
En Occident, ensuite, aussi bien Aristote que Platon, sauf quelques oeuvres, dont la Logique d'Aristote, sont perdus jusqu'au XIIème siècle et, surtout toute l'histoire de la philosophie dans la Chrétienté occidentale est marquée, entre IXème et XIème siècle, par la question célèbres des "universaux". La question fondamentale est alors celle de savoir si les représentations mentales, qui généralisent le réel, ont un lien -et lequel- avec les objets réels dont il est question et qui, eux, ont chacun leur unicité (par exemple, lorsque l'on parle des fleurs, en tant que catégorie générale -"les fleurs"- qu'est-ce que cela emporte lorque l'on considère une fleur, de telle variété, en particulier). Cette question, classique en philosophie, avait déjà trouvé, chez les Grecs, diverses réponses, au nombre de quatre: Platon pensait qu'il y avait correspondance entre les deux "mondes" du fait que la généralité, présente dans les catégories mentales de l'homme, se retrouvait aussi dans le monde réel (théorie du "réalisme ultra"); des philosophes, tenant d'un point de vue dit le "nominalisme", prenait le parti d'un parallélisme inverse (c'est dans le monde des représentations qu'il n'y a pas généralité mais diversité, comme dans le monde réel et les deux mondes sont donc aussi parallèles); les Stoïciens, eux, pensaient que les représentations générales existaient bien mais qu'il ne pouvait y avoir qu'incertitude sur les liens entre les représentations du réel et le réel (théorie du "conceptualisme"); Aristote, lui, pensait, sur un plan plus scientifique, qu'il y avait harmonie entre les concepts -généraux- et le réel -divers (théorie du "réalisme modéré")
Ce débat n'est pas anodin: si l'on n'admet pas que les concepts, les représentations mentales et générales sont possibles, on empêche, finalement, toute possibilité d'appréhension théorique, et donc scientifique, du monde voire toute métaphysique. On verse alors, dans un monde de l'individualisme à l'infini et de l'absence de toute idée et représentation générales, de tout principe possible (en terme de religion, le refus des universaux empêcherait toute base solide des religions et des dogmes, les soumettant à la variabilité permanente, au relativisme et au sujectivisme)
Les penseurs du Haut Moyen Age, qui perpétuent la pensée philosophique, n'ont cependant pas les moyens intellectuels de telles subtilités mais le débat reste sous-jacent, alimentant sans doute tous les débats autour du dogme et de l'hérésie. Les auteurs les plus nombreux, appelés des "réalistes" pensent qu'il existe bien des universaux et que tout objet réel en découle: ainsi Frédugise, Rémy d'Auxerre et Scott Erigène, qui se basent sur un auteur, Porphyre et sur Boèce. C'est la tendance dominante de l'époque et sans doute à tendance néo-platonicienne. Les partisans du point de vue inverse sont appelés les "nominalistes" ou "anti-réalistes": ils pensent que seul les objets du réel ont une existence, et pas les concepts, qui ne sont que pure théorie, allant donc dans le sens, eux, d'une forme de "matérialisme". Cette position des "nominalistes", cependant, doit essentiellement être perçue comme ce qui a permis l'évolution de la scholastique vers son achèvement, au XIIIème siècle. Tous ces débats -après d'ailleurs avoir généré des positions hérétiques de type panthéiste ou celles des Albigeois- via Abélard (vers 1100), qui théorise le rôle de l'abstraction, puis Jean de Salisbury (XIIème siècle, dans le cadre du développement des droits de l'Eglise), la scholastique finit, sous l'influence de l'incorporation contrôlée d'Aristote (en l'expurgeant des scories des traductions arabes d'Avicenne et Averroès), au XIIIème siècle par développer définitivement, sur la question des universaux, une théorie modérée, que l'on qualifie de "réalisme modéré thomiste aristotélicien". L'arrivée des pensées arabes et byzantines, à la fin du XIIème siècle, a amené, d'abord, une forte opposition à la scholastique (Siger de Brabant à Paris). Se maintiennent, à l'apogée de la scholastique, des néo-platonistes (Roger Bacon, Lull)
Pour les scholastiques, les objets de nos notions intellectuels -en fait les célèbres "idées" de Platon- n'existaient pas indépendamment des données individuelles venant de nos sens mais étaient considérés comme cette réalité. Celle-ci, en effet, se révéle aussi bien sous une forme abstraite, universelle et statique à l'intellect que sous une forme concrète, multiforme et dynamique à la perception sensorielle. Le problème que posent, en terme de religion catholique, ces réflexions philosophiques sur les vérités fondamentales de la vie et du monde est qu'elles sont en partie accessibles et en partie inaccessibles aux possibilités de la connaissance de l'homme. Et, finalement, elles questionnent profondément la vie des hommes et leur compréhension d'eux-mêmes et du monde. L'homme, par la raison, ne peut atteindre qu'un certain degré d'explication -ou de sagesse- mais la raison n'est plus d'aucune aide une fois tel(s) ou tel(s) point(s) atteint(s). Cela signifie donc soit que des limites existent, soit qu'alors, la métaphysique devient nécessaire. La Révélation chrétienne ayant donné une réponse définitive à ces questionnements fondamentaux, l'Eglise a donc toujours considéré tout effort philosophique indépendant comme une remise en cause d'elle-même
Les grands courants philosophiques après la scholastique
La question des universaux, venue de l'Antiquité, par le Moyen Age, et trouvant sa solution dans le réalisme modéré aristotélicien de l'apogée de la scholastique du XIIIème siècle, détermine ainsi largement tous les débats philosophiques ultérieurs: s'éloigner de cette solution modérée mène, d'un côté, par le conceptualisme et le nominalisme (dont les Stoïciens), au scepticisme et à l'agnosticisme, donc à une remise en cause de toute religion voire à l'empirisme et aux philosophies matérialistes et, de l'autre, par le réalisme ultra (platoniciste), à un idéalisme faux et au panthéisme
La fin du Moyen Age est marquée par des luttes qui opposent alors diverses écoles: les scholastiques, les scottistes (de Dun Scott), les ockhamiens (Guillaume d'Ockham; strict conceptualisme: les concepts existent, mais pas dans la nature (sinon par une représentation de l'esprit) et ils sont donc essentiellement utiles pour l'esprit), les averroïstes, etc. Puis la Renaissance voit se développer tout un ensemble de courants divers: des dialecticiens humanistes (Valla, Vivès), des renaissances de mouvements antiques (le platonisme, l'aristotélisme, le stoïcisme), des naturalistes (Giordano Bruno, Campanella), des penseurs (Thomas More ou Grotius) qui théorisent sur les lois naturelles ou sociales, le point commun de tous ces mouvements étant d'être ligués contre la scholastique et le catholicisme. Toutes les pensées de la Renaissance sont un négativisme, une "attitude contre". La scholastique ne se maintient, au XVIème siècle, qu'en Espagne mais ses praticiens ne la maîtrisent plus vraiment et elle finit par disparaître au XVIIème siècle
L'attitude destructrice de la Renaissance se continue par les volontés émancipatrices des dogmes et l'individualisme du XVIIème siècle: Descartes (spiritualisme fondé sur les données venant de la conscience), Malebranche, Spinoza, Leibniz et le sensualisme de Francis Bacon (les données de la connaissance ne viennent que des sens). Ce sera le sensualisme qui s'imposera comme la philosophie dominante du XVIIIème siècle et des Lumières (Hobbes, Locke, Berkeley, Hume, Condillac, les Encyclopédistes, Voltaire) et Rousseau le popularisera dans les masses, le tout sapant définitivement le catholicisme et menant aux grandes révolutions libérales. Ce sera Kant qui définira ensuite l'autre grand courant de la philosophie moderne: la "philosophie critique" (tout se ramène à la structure de l'esprit), amenant Fichte, Hegel, des panthéistes, Schopenhauer ou des individualistes. Le kantisme est essentiellement un conceptualisme, qui pense qu'il n'y a pas de lien entre le concept et le monde réel. Kant, lui-même, surtout en Angleterre, à partir de l'influence d'Auguste Comte, sera remplacé par le positivisme, qui est un nominalisme (Hume, Mill, Taine)
La question de la philosophie et de la religion
Après que les hindous aient lié religion et philosophie, que les Grecs, avec Socrate, aient tendu à se rendre indépendants de la religion, que Platon l'ait réincorporée et qu'Aristote en soit revenu essentiellement à l'indépendance (Dieu n'est que le premier moteur du monde) et, qu'enfin, le néo-platonisme, la religion revenant à la mode entre 300 avt. J.-C. et 300 ap. J.-C., ait de nouveau fondu la philosophie dans la religion (elle doit viser à unir l'âme avec Dieu par les pratiques mystiques), le catholicisme apporte une logique totalement nouvelle: le christianisme fournit les grandes réponses que s'étaient posées jusque là les philosophes mais, techniquement, il n'est pas une philosophie. Le grand tournant est amorcé: les Pères de l'Eglise, qui sont surtout des Grecs, sont influencés, bien évidemment, par le néo-platonicisme et le lien net entre philosophie et religion, mais la philosophie n'est plus désormais qu'un moyen d'argumenter pour défendre le catholicisme dans les grands débats fondateurs contre les hérésies. Cette conception restera celle du Haut Moyen Age: le néo-platonicisme au service de la religion, ce à quoi se ralliera même Erigène
Bien que Boèce ait fait connaître les divisions de la philosophie d'Aristote (dont celle des sciences de la théorie), le Haut Moyen Age ne connaîtra essentiellement que la division de Platon (en fait du néo-platonicisme) en logique, éthique et physique. Bien que théoriquement réduite à la dialectique, l'un des arts libéraux, la philosophie ne tarda pas à venir couronner l'ensemble des arts libéraux, devenant très à la mode à l'époque carolingienne et frôlant la pure technique (certains finissent par lui attribuer une valeur absolue et versent dans l'hérésie -Gottschalk, par exemple). Des problèmes théologiques mènent à des questions philosophiques (ainis transsubstantiation et substance). La théologie, cependant, reste bien évidemment la réflexion prioritaire. Tout, à l'époque, philosophie et sciences, reste incorporé dans l'Eglise même si la question des universaux, cependant, restent traitées pour elles-mêmes, en tant que questions seulement philosophiques, ce qui peut être dû à un problème d'"outillage intellectuel". Des débats, à partir du XIème siècle, se produisent entre opposants aux dialecticiens (Pierre Damien, réformateurs des ordres monastiques) et auteurs qui osent encore utiliser le raisonnement (les mécaniques de la philosophie) comme auxiliaire du raisonnement théologique (Lanfranc, St Anselme de Canterbury). L'apogée de la scholastique, avec les aquinistes, au XIIIème siècle, définit définitivement les rapports entre religion et philosophie: le raisonnement n'est que secondaire et n'est utilisé que pour confirmer les arguments d'autorité par les argumens de raison. On a là un strict retour aux méthodes apologétiques et aux Pères de l'Eglise des débuts. Le retour d'Aristote tient sans doute au fait qu'il donne la première place, dans ses catégories philosophiques, à la métaphysique. Les grandes "sommes" théologiques du XIIIème siècle restent de la théologie et ne sont pas de la philosophie. Ce strict point de vue, très augustinien, n'empêche cependant pas les scholastiques d'admettre que la philosophie a une forme de valeur indépendante qui lui permet d'être étudiée pour elle-même (on peut alors distinguer entre théologie scholastique (science du dogme, fondée sur les Ecritures) et philosophie scholastique (science fondée sur l'investigation rationnelle)). La philosophie est une science qui ne doit tirer son objet, ses principes et sa méthode que de ses ressources et pas d'une autre science, maintenant ainsi les positions modérées, réalistes, de la pensée catholique
L'évolution ensuite (ainsi Dun Scott, les Ockhamiens) accroît cette indépendance de la philosophie. Un mouvement, dit des "Averroïstes latins" (XIIIème, XIVème siècles) par leur aristotélisme averroïste, accentue encore la tendance, à la limite de l'irrespect de la théologie (ils restent cependant en-deça des vrais averroïstes arabes qui, eux, par exemple, voyaient l'Islam comme juste bon pour les masses). C'est ce lien subtil entre philosophie et religion que la Renaissance détruit (par un théisme, forme de naturisme appliqué même à la religion, par une forme d'oecuménisme précoce et mal compris, par l'indifférentisme qui gagne les catholiques à partir de l'influence des Réformés) et, finalement, cette indifférentisme de la Renaissance mène, aux XVIIème et XVIIIème siècles au mépris actif du catholicisme (théisme, déisme: une religion innée permet de construire une "religion naturelle" réduite à l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme. Bayle, en France, y ajoutera une vraie haine du catholicisme. Puis Voltaire). Le tout menant à l'athéisme et aux révolutions libérales
Supplément: quelques notions de bases sur les systèmes philosophiques non-occidentaux
Le monde occidental, essentiellement par le biais des routes du commerce, a pu être en relations avec des idées ou des concepts appartenant aux systèmes de pensée des autres régions du monde. En voici le bref aperçu:
- philosophies d'influence possible sur les Grecs, le monde arabe ou d'autres systèmes: la philosophie babylonienne qui est surtout une morale puis, vers le VIIIème siècle avt. J.-C., une tendance à la science -par l'astrologie- peut avoir eu une influence sur les Grecs à la période hellénistique, en particulier sur les Sophistes voire Platon et Socrate. A Sumer les écrits "modernes" (archives, textes religieux, chroniques, etc.) ne commencent d'apparaître que vers l'an 4000 avt. J.C. Jusque là les premiers textes écrits des tablettes cunéiformes n'étaient que des comptes de biens économiques. Une place, au sein de la philosophie grecque, doit être faite aux correspondances que Platon avait établi entre les éléments fondamentaux, 8 spirales constituant le système solaire -chacune avec sa planète, une couleur et une sirène tenant une note- 8 volumes basiques et la musique -les fréquences musicales. Tout cela formant une sorte d'harmonie universelle que l'on pourrait trouver des étoiles aux végétaux de la Terre. Ces vues furent reprises par la suite par l'astronome Képler qui les appliqua à sa théorie des orbites planétaires puis par Goethe qui pensait que la quinte, en musique, existait dans toute musique sacrée. La quinte, par ailleurs, est caractéristique, aussi, du chant grégorien alors que certains prétendent que les cathédrales gothiques et les temples égyptiens ont été bâties sur la base de la géométrie sacrée et de l'acoustique harmonique. Pour Platon, le monde est un être vivant, animé par une âme. Platon fonde mathématiquement l'ordonnance du ciel d'un point de vue astronomique sans en approfondir les principes métaphysiques et en laissant volontairement au mythe le soin de répondre à des questions que la science soulève. Le monde est néanmoins l'oeuvre d'un démiurge et Platon en parle parfois en l'appelant Dieu, ou encore "celui qui institue une genèse". Ce démiurge cependant relève plus de l'artisan; l'âme, elle, est constituée en fonction de rapports arithmétiques et harmoniques qui en font, sinon une harmonie, du moins une productrice d'harmonies dans ce ciel qu'elle anime. Platon dit aussi que Dieu plaça l'intellect dans l'âme et l'âme dans le corps. La philosophie indienne (peu d'influence, finalement, et assez centrée sur le monde indien et ses extensions mais avec une tendance au syncrétisme et à l'universalisme). Le yoga, lui, s'est développé au VIème siècle et fut le fait de dissidents de la doctrine officielle, laquelle insistait sur les sacrifices et les "actions extérieures"; les yogis, eux, insistèrent sur la paix intérieure et la pureté. La médecine ayurvédique, en Inde (de "ayur", vie et "veda", science, connaissance), s'appuie sur une philosophie dans laquelle l'Univers est composé de 5 éléments (terre, eau, feu, air, espace) et sur un équilibre entre 3 humeurs (vent, esprit ou air; feu, bile; terre, eau, mucus). Chaque individu est dominé par une ou plusieurs de ces humeurs. La thérapie vise l'individu dans sa globalité (alimentation, style de vie, etc.). L'ayurvéda inclut des disciplines thérapeutiques variées: chirurgie, pédiatrie, médecine, aphrodisiaques, constitution de l'immunité, toxicologie (avec cures de détoxication) ou possession démoniaque. Les diverses épices indiennes participent à cette médecine. L'université de Nalanda, dans l'actuel état du Bihar, dans l'Est de l'Inde, fut un célèbre centre boudhiste d'érudition entre les Vème et 12ème siècles. 2000 enseignants, 10000 étudiants y participaient et 100 domaines y étaient étudiés: philosophie, théologie, arts, science. La renommée de l'un des plus anciens centres d'études devint telle qu'elle attira des étudiants venant de Chine, Corée, Tibet, Mongolie, Ceylan ou de Turquie. Elle fut finalement détruite en 1193. La largeur des murs conservaient l'air frais et de grands espaces ouverts permettaient l'interactivité. La philosophie perse classique -le zoroastrisme- est la classique opposition entre les forces du bien et du mal, repris par le manichéisme (qui fut combattu par St Augustin, qui s'y était converti, et qui fut la religion officielle des Sassanides, le dernier empire perse avant l'invasion arabe) voire le mazdakisme, une forme de proto-communisme. Le zoroastrisme fut fondé par Zoroastre en Perse au VIème siècle avt. J.-C.; il se fonde sur le dualisme du bien et du mal qui se livrent une lutte perpétuelle. Cependant, le corps et l'esprit des fidèles, eux, sont unis dans le combat contre le mal mais l'âme est immortelle et ceux qui auront mené une vie correcte atteindront un au-delà agréable. Les morts sont laissés aux vautours dans des "tours du silence". Après le passage de la Perse au monde islamique au VIIème siècle, les zoroastriens finirent par émigrer en Inde où ils formèrent les parsis
- monde musulman: la philosophie naît de l'"ijtihad", la méthode d'interprétation des points restés obscurs dans la révélation de Mahomet. Le principal mouvement philosophie dans l'Islam est ensuite le "motazilisme", doctrine officielle du califat à partir de 827 ("Maison de la Sagesse" ("Dar al-Hikma") de Baghdad en 832, où des traducteurs chrétiens traduisent les ouvrages grecs). Les milieux intellectuels persans et arabes reçoivent la culture grecque (dont le néo-platonisme), persane et indienne par le biais de la direction d'un Arabe chrétien nestorien, Hunayn ibn Ishaq, dans les années 870, ce qui fonde tous les travaux des IXème et Xème siècles (Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenne, Averroès). Une école concurrente se développe, le "Kalâm". Les débats, en Islam, portent surtout sur l'opposition entre libre arbitre et fatalisme, les motazilites développant la défense du libre arbitre et du rationalisme, les musulmans "orthodoxes" les rejetant. Le motazilisme est une école théologique musulmane qui fut fondée à Bassora (actuel Irak) au VIIIème siècle; au contraire de la prédominance du concept de fatalisme dans l'Islam, cette école se fit le défenseur de ce que la liberté humaine existait et que Dieu la respectait. La philosophie arabe, du fait de la géographie du monde arabe est au confluent des influences juives, chrétiennes, grecques, perses et indiennes. Après une apothésose atteinte au XIIème siècle (Al-Ghazali, Juda Halevi) le débat se clôt lorsque le motazilisme disparaît au XIIIème siècle et que les orthodoxes de l'Islam s'en prennent à tous les philosophes et font brûler les livres, qui disparaissent aussi du fait des invasions mongoles et des croisades. Le soufisme est une tendance mystique de l'Islam apparaissant vers l'an 800
- judaïsme: Philon, à Alexandrie, aux débuts de l'ère chrétienne, représente l'acceptation de l'influence hellénique sur le monde juif et développe l'idée que la philosophie est le moyen de défendre les véritées révélées du judaïsme voire de faire du prosélytisme. Par le biais de l'Ecole de la Maison de la Sagesse abasside et par le néo-platonisme, la philosophie se renouvelle par les Juifs d'Espagne. Plusieurs tendances existent à l'époque du Moyen Age occidental: Juda Halevi (XIIème siècle) contrant les adversaires du judaïsme, Abraham ibn Dawd Halevi (vers 1150) est aristotélicien ainsi que, surtout, Maimonide (fin du XIIème siècle) qui essaie de résoudre les contradictions entre la Bible et l'approche intellectuelle, démontrant que certaines trivialités dans le texte saint ont en fait une signification spirituelle
- bouddhisme: le bouddhisme est né d'un rejet de l'hindouisme au Vème siècle avt. J.-C. Le prince Siddhartha Gautama, à l'âge de 29 ans, partit à la recherche de comment débarasser le monde de la souffrance et, à 35 ans, il atteignit le "nirvana" ("état de pleine conscience") et devint le "Bouddha", "l'Eveillé". En réaction aux rigidités de l'hindouisme, il critiqua le système des castes et la vénération des dieux, demandant à ses disciples de rechercher la vérité via leur expérience propre. Selon Bouddha, il faut se débarasser de la souffrance, qui naît de la convoitise, en éliminant les désirs via l'"Octuple sentier": justesse de la connaissance, de l'intention, de la parole, de l'action, du mode de vie, de l'effort, de l'attention et de la concentration, ce qui mène au nirvana. Installé dans différents pays, de l'Afghanistan au Japon, le bouddhisme connaît une variété d'écoles aussi importantes que celles du monde occidental puis n'en laisse subsister que deux (le "Cittamatra" ou "rien qu'esprit" (IVème siècle de l'ère chrétienne; un idéalisme: toute la réalité n'est que des faits de conscience pour les non-délivrés du cycle de la souffrance) et le "Madhyamaka" ou "voie du milieu (IIème siècle de l'ère chrétienne; un refus du monde encore plus excessif; toute philosophie ne peut qu'être négative avec un rejet de quasi-tout)). La philosophie, dans le bouddhisme, ne perd jamais de vue les fins religieuses de celui-ci
- jaïnisme: le jaïnisme naquit au VIème siècle avt. J.-C. en Inde, fondé par Mahavira en réaction aux castes et aux rites de l'hindouisme: la délivrance est atteinte par la totale purification de l'âme qu'on délivre du "karman", matière engendrée par les actions, par l'ascétisme. On doit aussi avoir une conduite juste via l'"ahimsa" ("non-violence") en pensée et en acte envers toute créature. Le jaïnisme connaît des laïcs et des moines dont des "sadhu", qui renoncent à toute possession matérielle et méditent, étudient les textes, se mortifient et se rendent aux pélerinages pour mener à bien la quête spirituelle
- Chine: comme pour le bouddhisme, la Chine ne fait pas bien la distinction entre religion et philosophie. L'écriture chinoise ne permet pas le "logos" grec mais la fluidité de l'esprit et la pratique plutôt que la théorie et la solidité des arguments. Matteo Ricci, le Jésuite qui fut le premier à s'installer en Chine, au XVIIème siècle, utilisa des notions tirées du stoïcisme et de la philosophie grecque pour mieux faire passer les concepts du catholicisme aux Chinois. Voltaire, par ailleurs, était entiché de tout ce qui était chinois. L'influence de Confucius, Kongfuzi, "Maître K'ong" (551-479 av. J.-C.), en Extrême-Orient, est telle qu'on peut la comparer à
celles de Platon voire l'Eglise en Occident. Se fondant sur les éléments de philosophie qui existaient déjà à l'époque, il postule que, de l'érudition et de la sagesse, éléments de la noblesse spirituelle qui ajoute à la noblesse de sang, découle, en cascade l'ordre social: elle justifie la pensée, la noblesse de coeur, la personne, la famille et, enfin, l'Etat. Le sage a trouvé le "li", l'harmonie entre l'homme et l'ordre général du monde. La musique joue un rôle important dans le confucianisme, symbole d'ordre et d'harmonie et le confucéen rend un culte aux divinités et aux ancêtres. Le "ren" est l'autre pilier du confucianisme, cette bienveillance que le sage exerce. Il ne peut l'exercer, cependant, que dans le cadre d'une hiérarchie familiale et sociale très rigide. Le confucianisme, ainsi, a permis, en Extrême-Orient une organisation hiérarchique très forte des société et la prédominance de l'homme sur la femme. Le sage confucéen est toujours impliqué dans la société et l'ordre du monde. Les "Analectes" ou "Entretiens" de Confucius et leur interprétation et les "Cinq classiques" fondent la base du confucianisme. Alors que le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang s'était fondé sur le légalisme et le taoïsme -un Etat basé sur le droit pénal et non l'humanisme- une synthèse finit par se faire jour, faisant du confucianisme, au VIIème siècle, la base des concours mandarinaux. Depuis le IIIème siècle, il était finalement devenu philosophie d'Etat partageant son destin avec les autres philosophies chinoises (légalisme, taoïsme). Sous les Han (à partir de 200 apr. J.-C.), chaque ville centre d'administration disposait d'un temple consacré
à Confucius, un "wénmiào", "temple de la
littérature" souvent équipé d'une bibliothèque. Ce sera, finalement, une évolution, le "néo-confucianisme", entre IIème et VIIIème siècle de notre ère, donc en partie sous les Tang, influencé de taoïsme et de bouddhisme et dont la référence est l'auteur Mencius, un auteur d'après Confucius, qui assumera le rôle de philosophie officielle (définitivement au IXème siècle). Le néo-confucianisme recentre, après une période d'influence du bouddhisme, le confucianisme sur la morale. Il accordera une place à la nature et considère que chaque organisme remplit une fonction au sein d'un organisme plus vaste; ainsi, le Ciel, la Terre et la société sont liés. Au début des Tang, de nouvelles écoles pour lettrés
sont fondées, un corpus officiel des Classiques est reconstitué et les rites
confucianistes sont réinstaurés. Devenu le "néo-confucianisme", approfondi sous les Song, le mouvement devint, à son tour, philosophie d'Etat sous les Yuan, au XIIIème siècle. Les "Quatres livres" et le "Mencius" devinrent les bases des examens impériaux à partir du XIIème siècle. Ce néo-confucianisme est empreint de scientisme sur la base d'une pensée qui voit un "taiji', source générale se refléter dans le "li" individuel des différents êtres, animaux et choses du monde: il faut donc étudier ceux-ci. Puis il en revient à l'introspection du sage puisque le "qi", force qui remplit l’univers, peut obscurcir le "li". La philosophe chinoise, au moins à des débuts est donc en fait très mutile et pragmatique. Pour ce qui est du taoïsme, il est né vers l'an 0 est une façon de vie et une religion, s'axant sur la liberté, la mystique et la médecine; renouvelé par le néo-taoïsme à partir de vers 300 de l'ère chrétienne. Le taoïsme est en même temps une religion et une façon de penser; la quête de l'immortalité est l'ultime but du taoïsme. Philosophie, poésie, pragmatisme, mysticisme et superstition en font également partie. Vivre bien, vivre longtemps et devenir immortel sont les principaux désirs d'un taoïste. Le taoïsme, finalement, est un ensemble de comportements et de croyances qui conjuguent tous les aspects de la vie et du non-mourir. La méditation -avec concentration et visualisation dans une alchimie intérieure- l'art martial du taï-chi-chuan, les exercices respiratoires du "qigong" permettent aussi de vivre en société sans blesser ni se blesser. L'Univers, selon le taoïsme, était indifférencié à ses origines et il passa de l'unicité à la multiplicité sans intervention extérieure. La Grande Ourse et l'étoile polaire, au milieu du ciel, dispensent le souffle primordial ou "yuanqi", qui se transforme en les énergies opposées et complémentaires du ying et du yang. Le taoïsme, ainsi, est aussi la recherche d'un accord harmonieux entre l'homme et l'Univers; il est aussi un naturalisme. Lao-Tseu (ou Laozi) fut le fondateur du taoïsme et il aurait vécu entre le VIème et le Vème siècle avt. J.-C. à la cour des Zhou. Il y était historien-archiviste et il choisit de quitter, à dos de buffle, la cour qu'il jugeait décadente. A la frontière occidentale du royaume, il fut convaincu de mettre par écrit son enseignement, ce qui devint "
Le livre de la Voie et de la vertu". Lao-Tseu fut finalement divinisé. La taoïsme devint aussi partie de la formation des fonctionnaires impériaux, qui devaient en suivre un apprentissage long et marqué de différentes étapes. Le taoïsme est resté une tradition vivante et ouverte, qui continua d'évoluer. Le Tigre blanc, l'Oiseau vermillon, la Tortue noire et le Dragon bleu gouvernaient respectivement, vers l'an 300, les horizons ouest, sud, nord et est. Le shintoïsme du Japon a intégré, via la Corée, le confucianisme et le bouddhisme et développé la voie particulière du bouddhisme zen (une synthèse bouddhisme-taoïsme) des arts martiaux, alors qu'une vieille tradition philosophique et chamanique coréenne, elle, a incorpée le confucianisme et le bouddhisme, développant aussi des arts martiaux
- Afrique: surtout l'influence arabe, de l'Afrique du Nord aux royaumes musulmans des sahels
- Amérique colombienne: une certaine parenté avec l'hindouisme (unicité d'un être supérieur) et avec Platon. Les Incas sont les plus éloignés de ce schéma
Website Manager: G. Guichard, site Learning and Knowledge In the Carolingian Times / Erudition et savoir à l'époque carolingienne, http://schoolsempir.6te.net. Page Editor: G. Guichard. last edited: 8/1/2016. contact us at geguicha@outlook.com