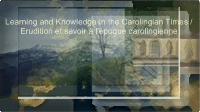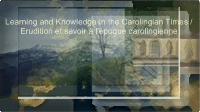


La Maison de la Sagesse de Bagdad
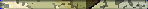
Les califes abbassides de Bagdad développèrent une attitude libérale à l'égard des sciences et de la philosophie. Ils mirent en place la "Maison de la Sagesse", un centre d'érudition. Cette culture était à base scientifique mais, déjà, l'école de pensée hanbalite affirmait que seule la science du Coran et de la Sunna étaient autorisées. Du fait des ambassades échangées entre les Carolingiens et les Abassides ou du fait que Bagdad était une étape des Rhadanites, ces marchands du grand commerce, il est probable que les connaissances aient circulé du Califat arabe jusque dans l'Empire carolingien. Le Califat arabe s'affirmait comme un successeur plus légitime au vieil Empire romain que l'Empire byzantin
Une figure emblématique de l'Islam libéral
La grande querelle du libre arbitre, qui commença sous les Omeyades, vint des convertis chrétiens qui aidèrent à développer la théologie musulmane. La Maison de la Sagesse ("Beït al Hikma", en arabe) est un centre d'érudition situé à Bagdad aux temps de l'empire abbasside. A l'époque où Charlemagne lançait la renaissance carolingienne, le calife Haroun al-Rachid et son fils al-Mamun (813-833) créèrent cette institution, une bibliothèque et centre d'érudits. Les califes abbassides étaient largement influencé par la culture persane et ils avaient repris de nombreuses pratiques des Sassanides, la dernière dynastie non-islamique de Perse; entre autres, de traduire des ouvrages en langue étrangère. L’Iran sassanide était en contact étroit avec la Chine et a donc passé une partie de cet héritage aux Arabes. L'Empire Sassanide, dans l'Antiquité tardive, est considérée comme l'apogée de la civilisation iranienne et il influença considérablement la culture romaine à l'époque et son influence atteint aussi l'Afrique, l'Inde et la Chine. Une grande partie de la culture islamique y trouva aussi ses racines. Quand, en 529, l'empereur byzantin Justinien avait fait fermer les écoles philosophiques d'Athènes, les érudits néo-platoniciens se réfugièrent chez les Sassanides où, dans la ville de Gundishapur, ils fondèrent une académie qui développa intensivement l'astronomie, la médecine, la philosophie et les autres sciences, y attirant encore d'autres érudits. Le monde arabe hérita de tout cela et le calife Al-Mansur, ainsi, fonda une bibliothèque du palais à l'imitation de la Bibliothèque Impériale sassanide. La Maison de la Sagesse, au départ, eut pour but de traduire et conserver les ouvrages en langue persane, effort qui s'étendit à des oeuvres en syriaque, en grec et en sanskrit. D'autres grandes bibliothèques furent construites dans l'empire abbasside et les califes accueillirent des érudits byzantins persécutés dans leur pays. Sous al-Mamun, les plus connus des lettrés et des savants, de par le monde d'alors, échangèrent leurs idées et leurs données dans la Maison de la Sagesse. Celle-ci exista jusqu'au XIIIème siècle et fut le lieu où exercèrent, en termes de recherche et d'éducation, les plus grands érudits arabes. C'est à l'époque abbasside que l'on voit apparaître les premiers manuscrits scientifiques. On construisit aussi des observatoires astronomiques. La Maison de la Sagesse devint le centre incontesté des études humanistes et scientifiques du monde islamique. Pour ce qui est des sciences, on y pratiquait les mathématiques, l'astronomie, la médecine, l'alchimie ou la chimie, la zoologie et la géographie. Les érudits arabes se servaient des travaux d'auteurs perses, indiens et grecs: Sushruta, Charaka, Aryabhata, Brahmagupta; Pythagore, Platon, Aristote, Hippocrate, Euclide, Plotin, Galien. Les Arabes appelaient la phisolophie grecque et hellénistique la "philosophie des anciens". Cela leur fournissait ainsi une vaste base de données, à caractère mondialisé, sur lesquelles, de plus, ils menèrent leurs propres travaux. Bagdad, à l'époque, était devenue la ville la plus prospère et la plus intellectuelle du monde; des marchands et des savants y venaient de l'Inde ou de la Chine. La Maison de la Sagesse bénéficia aussi de l'utilisation, nouvelle, du papier qui remplaça avantageusement le papyrus, trop fragile ou le parchemin, qui était cher; l'invention avait été prise à des prisonniers chinois faits à la bataille de Talas, en Asie Centrale en 751, qui avait marqué la délimitation des zones d'influence arabe et chinoise; elle permit les innombrables livres qui furent publiés à la Maison de la Sagesse. Un grand volume d'information, à l'époque -philosophie, mathématiques, sciences, médecine- était disponible en grec mais n'était donc accessible qu'à la petite minorité de savants arabes qui maîtrisaient le grec. Un peu après, le cosmopolitisme du monde arabe et les origines et religions diverses des savants (dont, aussi, des Sabéens, des zoroastriens, par exemple) firent que, dès l'époque carolingienne, l'arabe devint la langue scientifique (l'équivalent de ce qu'est l'anglais de nos jours); les Arabes, ainsi, inventèrent aussi le premier concept de communauté scientifique "internationale": on ne se préoccupait pas de l'origine d'un savant, on se contentait d'apprécier, ou de critiquer, ses oeuvres
L'autre aspect principal de ce mouvement intellectuel arabe sous les Abassides, jusqu'en 847, est qu'il représente l'une des attitudes les plus libérales de l'Islam, en termes intellectuels, au long de son histoire. Le calife al-Mamun, en effet, était partisan du motazilisme, une école philosophique particulière. Celle-ci était devenue la théologie officielle des Abbassides depuis 827, sous le calife Al-Mamoun et elle eut ses écoles à Bagdad et Bassora. Le motazilisme était née à Bassorah, dans le Sud de l'Irak, au VIIIème siècle. Le monde islamique, entre autres, pour l'interprétation des passages obscurs du Coran, utilisait une méthode intellectuelle officielle, dite de l'"idjtihad". L'exégèse du Coran devint une sorte de philosophie religieuse, le "kâlam". La recherche sur des contradictions du texte coranique finit par faire considérer les motazilites comme des hérétiques. A la fois ils renforcèrent l'unicité du Dieu arabe (en lui refusant tout attribut) et ils affirmèrent le libre-arbitre de l'homme (comme moyen de concilier l'idée de prédestination et celle de punitions et de réécompenses futures). Pour bâtir leurs raisonnements, ils utilisèrent la philosophie des Grecs d'Alexandrie en donnant au texte un sens allégorique. Les points de vue du motazilisme provoquèrent en retour des réactions chez les musulmans orthodoxes. L'école anthropomorphique, par exemple, prit le Coran à la lettre, et déduisait de certains passages l'aspect physique d'Allah. Le motazilisme ira très loin, jusqu'à l'incrédulité: Abou-l-Ala, un poète du début du Xème siècle, affirmera que Musulmans, Juifs, Chrétiens et mages sont dans l'erreur car il n’y a plus que deux espèces d’hommes, les uns intelligents mais incrédules, les autres croyants mais manquant d'intelligence. Le calife al-Mutawakil, après 847, commença à freiner ces efforts, lui suivant l'Islam orthodoxe. Les motazilistes atteignirent leur apogée au XIIème siècle mais ils finirent par cèder la place aux orthodoxes, plus rigoureux. L'effort de l'idjtihad fut également stoppé par les invasions mongoles et par les Croisades. On dit qu'au cours de la prise de Bagdad par les Mongols, en 1258, le Tigre charria pendant six mois l'encre des livres jetés à l'eau. La Maison de la Sagesse fut également brûlée. Le premier déclin de la Maison de la Sagesse, sous le calife al-Mutawakkil est sans doute due à l'orthodoxie militante de celui-ci et aux violentes persécutions qu'il déclencha aussi bien contre les Musulmans non-orthodoxes que contre les penseurs non-musulmans; des rivalités de couloir, dans la Maison de la Sagesse elle-même, y ont peut-être contribué aussi
Enfin, comme, pour les chiites, le caractère divin du Coran fait que le texte est infini et a donc une infinité de sens et d'interprétation la conséquence en est que cette tendance de l'Islam est plus encline à se préoccuper de science et de recherches sur le monde, tendance qu'on ne retrouve pas dans l'Islam orthodoxe sunnite pour qui le Coran ne doit être compris qu'en arabe et est, pour l'essentiel, clos. Cela explique sans doute que la Maison de la Sagesse ait fleuri chez ces premiers califes abassides, dans une Bagdad où règnait la forte influence de l'Iran
Plus en détail
La Maison de la Sagesse est à l'origine de concepts originaux. On y connaissait -ainsi que dans les autres bibliothèques du monde arabe au Moyen Age- le fichier de bibliothèque: les livres étaient classés par matières et catégories. De nombreux ateliers d'artisans accompagnaient les activités de la bibliothèque abbasside et la plupart, de plus, servaient également de librairies. La plus grande, la librairie al-Nakim, vendait des milliers d'ouvrages chaque jour. C'est surtout sous le calife al-Ma'mun que la Maison de la Sagesse tourna son activité vers les mathématiques et l'astrologie et que son intérêt passa des traductions du persan à celles du grec. Bien que les universités -en tant que cadre institutionnalisé pour l'enseignement- n'existaient pas encore, certaines institutions, dites "maktabs" commencèrent à se développer à Bagdad dès le IXème siècle et la première vraie université fut fondée au XIème siècle, la al-Nizamiyya qui était la plus grande de l'époque
Au temps des Abbassides, la Maison de la Sagesse était placée sous la direction du poète et astrologue Sahl ibn Haroun (mort en 830) et c'était un érudit chrétien nestorien Hunain ibn Ishaq (809-973) qui avait en charge les travaux de traduction. La priorité aux traductions déclina mais la Maison de la Sagesse continua d'être florissante sous les successeurs d'al-Mamoun, jusqu'en 847. Les traductions de l'époque abbasside furent supérieures à celles des époques précédentes. Pendant les VIIIème et IXème siècles, Bagdad fut, sans rivaux, le seul centre de culture et de science du monde arabe -entendu de l'Espagne et du Maroc à l'Asie Centrale. Cependant, au cours du Xème siècle, cette suprématie commença de faiblir, probablement en liaison avec le déclin des Abbassides. D'autres centres de culture étaient alors apparus dans la même zone: Cordoue, Kairouan, Le Caire, Alep et Damas, Mossoul et Al-Raqqa, Rayy et Chiraz, ou Khwaazm et Boukhara. Le monde arabe, en termes de culture, était devenu pluri-centré, les deux aires les plus représentatives étant l'Espagne musulmane et l'Afrique du Nord, d'une part, et le Moyen-Orient. A Boukhara, sous les Samanides, Al-Kharezmi (787-850) fut un mathématicien notable. Ibn Sina (980-1037), le fondateur de la médecine occidentale dont l'influence se maintint jusqu'au XVIIème siècle, ou Al Biruni (973-1046), astronome qui estima la distance Terre-Lune et qui affirma que la Terre tournait sur elle-même et autour du Soleil, furent également des gloires de la ville. Malgré les ambassades échangées entre l'Empire carolingien et le califat arabe, on sait mal quelle influence ces travaux purent avoir en Occident. Il semble à peu près certain, cependant, que certaines connaissances astronomiques arabes ont pu atteindre Aix-la-Chapelle. On notera, sur ce point, que d'après le "Livre des étoiles fixes" de l'astronome Al-Sufi (ou Azophi), les constellations, dans le monde arabe, au Xème siècle, avaient quitté leurs formes grecques pour revêtir celles de la culture des tribus des caravanes
Les érudits de la Maison de la Sagesse
Suivent quelques notices concernant les érudits arabes liés à la Maison de la Sagesse à l'époque abbasside
- Hunayn ibn Ishaq (Abu Zayd ?unayn ibn 'Is?aq al-'Ibadi; connu aussi sous le nom latin de Johannitius) (809-873). Erudit nestorian, médecin et scientifique, il fut l'artisant principal des translations des ouvrages grecs en arabe et en syriaque à la Maison de la Sagesse. Il est également considéré comme ayant fondé la médecine arabe. Ishaq, avec l'aide de son fils et de son neveu, traduisit 116 ouvrages, dont l'Ancien Testament et il écrivit 36 ouvrages en tant qu'auteur. On le connaît, dans le monde arabe, comme le "cheikh des traducteurs". Né dans l'Iraq du Sud, il fit des études de médecine à Bagdad et il apprit le grec lors de voyages à Alexandrie et Byzance. Il savait aussi le syriaque et le persan. Il traduisit Platon et Aristote, des ouvrages sur l'agriculture, les bijoux et la religion ainsi que de nombreux textes et résumé en matière de médecine -surtout ceux de Galien; il travailla aussi sur la grammaire arabe et la lexicographie médicaux. A la différence des traducteurs qui l'avaient précédé, Ishaq refusait la traduction mot à mot mais il essayait, au contraire, de rendre le sens des phrases et du sujet traité. Ses traductions, augmentées, de plus, d'autres sources sur le sujet qu'elles traitaient, finissaient ainsi par devenir des traités en eux-mêmes. Cette méthode fut reprise par des traducteurs postérieurs. Ishaq devint le médecin personnel du calife al-Mutawakil. Sa traduction du "De Materia Medica" un manuel de pharmacie et, surtout, celle de sa partie résumée et populaire, les "Questions sur la médecine", fut très utile aux étudiants de l'époque car cela représentait un excellent guide introductif. L'un des domaines médicaux auxquels Ishaq contribua fortement est l'ophthalmologie
- Thabit ibn Qurra (connu sous le nom de Thebit en latin) (836-18/02/901). Né à Carrhes, au Nord de Bagdad, il prit la succession de Hunayn ibn Ishaq comme traducteur principal de la Maison de la Sagesse (il y avait été invité par Muhammad bin Musa bin Shakir, l'un des frères Banu Musa). Il appartenait soit à la secte des Sabiens, une secte d'Hermès Trismégiste, soit à celle des Mandéens. Les deux, en tout cas, avait un fort intérêt pour l'astronomie, l'astrologie et les mathématiques (spécialement, pour celles-ci, les Mandéens). L'une des sectes vit sa capitale devenir un centre d'érudition philosophie, ésotérique et médicale à l'époque du calife al-Mutawakkil. Ils avaient été rejoints par des descendants de savants grecs païens qui avaient fui l'Empire byzantin. Médecin mandéen, Thabit étudia les mathématiques, l'astronomie, l'astrologie, la magie, la mécanique, la médecine et la philosophie. Sa langue natale était le syriaque (qui est le dialecte araméen de la région d'Edesse) et il connaissait également bien le grec. Il traduisit Apollonius, Archimède, Euclide et Ptolémée (dont la "Géographie") et il révisa les traductions des Eléments d'Euclide qu'avait faite Hunayn ibn Ishaq; il ré-écrivit aussi sa traduction de l'Almageste de Ptolémée. Plus avant dans sa vie, Thabit devint l'ami personnel et le courtier du calife al-Mu'tadid (892–902). Il mourut à Bagdad. Thabit étudia les courbes que nécessitait la construction de cadrans solaires et il fit faire des pas importants à de nombreux domaines de la connaissance: en astronomie, l'instabilité des équinoxes, la longueur de l'année sidérale en astronomie; en mathématiques, l'équation pour déterminer les nombres amicaux, l'extension de leur usage à la description des relations entre quantités géométriques (un pas que les Grecs n'avaient pas franchi) ou la généralisation du théorème de Pythagore des triangles rectangles aux triangles en général. En physique aussi, Thabit fit des pas importants: il rejetait les notions d'"emplacement naturel" des corps et éléments des Péripatéticiens et des aristotéliciens qu'il remplaçait par une théorie du mouvement gouvernée par le poids, lequel engendrait les mouvements vers le haut ou le bas; il proposa aussi une théorie, encore approximative, de la gravité
- les frères Banu Musa (ou les "fils de Musa"). Ce sont trois érudits perses, de Bagdad, qui travaillèrent au sein de la Maison de la Sagesse. Abu Ja'far Muhammad ibn Musa ibn Shakir (avant 803–873) a produits des oeuvres en astronomie, ingénierie, géométrie et physique; Ahmad ibn Musa ibn Shakir (803-873) en ingénierie et en mécanique. Al-Hasan ibn Musa ibn Shakir (810-873) en ingénierie et en géométrie. Confiés par le calife à l'ancien gouverneur de Bagdad après la mort de leur père, qui était un responsable des postes puis l'astrologue du calife al-Mamun, ils reçurent leur éducation de Yahya bin Abu Mansur, qui faisait partie de la Maison de la Sagesse. Les trois frères construisirent nombre de machines automatiques et de systèmes mécaniques. Ils en décrivent des centaines dans le "Livres des systèmes ingénieux"; ces systèmes étaient pour la plupart déjà connu des Grecs et des Romains: joueur automatique de flûte, pression différentielle et divers systèmes d'ingénierie. On leur doit aussi le premier instrument mécanique musical: un orgue mû par de l'eau qui jouait des cylindres à picots. Le traité le plus célèbre des Banu Musa en terme de mathématiques est le "Livre de la mesure des figures planes et sphériques", qui aborde des problèmes semblables à ceux d'Archimède. Muhammad ibn Musa, qui travailla en physique et en astronomie, fut un pionnier en astrophysique et en mécanique céleste. Dans son "Livre sur le mouvement des orbes", il montre que les corps et les sphères célestes sont sujets aux mêmes lois physique que la Terre alors que les philosophes de l'Antiquité pensaient qu'ils suivaient les leurs propres. Ahmad ibn Musa se spécialisa en mécanique et écrivit un ouvrage sur les machines pneumatiques. Le plus jeune des frères al-Hasan, travailla sur les ellipses
- Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (ou al-Khwarizmi) (vers 780, Khwarizm-vers 850). Il s'agit du célèbre al-Khwarizmi, le fondateur de l'algèbre. Il était né en Perse, dans la ville de Chorasmia (Khwarizm en persan). L'essentiel de son oeuvre date d'entre 813 et 833, quand il était le directeur de la Maison de la Sagesse. Il travailla dans le domaine des sciences et des mathématiques, y compris des traductions de manuscrits en grec et en sanskrit. Il est surtout connu pour ses travaux sur la solution des équations linéaires et au carré jusqu'au second degré, employant la méthode d'annuler les termes semblables de part et d'autre de l'équation. Il en produisit, en 830, l'ouvrage 'al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa'l-muqabala' ("Le livre abrégé sur la façon de calculer par complément et équilibre"). Il fonda ainsi l'algèbre moderne, laquelle, d'ailleurs, tire son nom de "al-jabr", l'une des deux opérations qu'il utilisait pour résoudre les équations au carré. L'autre de ses contributions majeures à la science fut qu'avec son "Calcul avec les chiffres indiens" de 825, il répandit le système numérique indien dans le Moyen-Orient puis en Europe. Son oeuvre mathématique servait au commerce, à l'arpentage et aux problèmes d'héritage. On doit considérer les travaux d'al-Khwarizmi comme la fondation des mathématiques modernes et une démarcation nette d'avec la vision grecque, fondée sur la géométrie, de cette science. Il produisit également des travaux en termes de trigonométrie. En astronomie, il systématisa et corrigea les données de Ptolémée concernant la géographie de l'Afrique et du Moyen-Orient, il améliora les coordonnées de celui-ci pour la Méditerranée, l'Asie et l'Afrique. Al-Khwarizmi estima également de façon correcte la longueur de la Méditerranée et, au contraire du savant grec qui en faisait des mers fermées, il fit de l'Océan Atlantique et de l'Océan Indien des mers ouvertes. Il dirigea, avec 70 géographes sous ses ordres, un projet pour déterminer la circonférence de la Terre et pour produire une carte du monde pour le calife al-Mamun. Il est également l'auteur du "Zij al-Sindhind" ("Tables astronomiques du Sind et du Hind"), la première d'une longue succession de tables astronomiques du monde arabe, se fondant sur les méthodes astronomiques indiennes connues sous le nom de "sindhind" et qui contiennent des données concernant le calendrier, l'astronomie et l'astrologie. Ce travail est une étape fondamentale de l'astronomie arabe car, jusque là, l'approche des scientifiques musulmans consistait à n'utiliser que des traductions. Al-Khwarizmi améliora aussi la construction des cadrans solaires, les rendant utilisables partout dans le monde et leur donnant leur forme moderne -une base carrée pour porter l'ombre et un stylet. Son "Quadrans Vetus", un cadran horaire universel, devint l'outil le plus utilisé par les savants médiévaux de l'Occident, après l'astrolabe. Une partie des travaux d'al-Khwarizmi se fonde sur l'astronomie perse et babylonienne, les chiffres indiens et les mathématiques grecques. Le nom d'al-Khwarizmi a fini par donner le mot "algorithme", d'"algoritmi", la forme latine de son nom. Guarismo, en espagnol et algarismo, en Portugais, qui signifient chiffre, viennent également de là
- Sind ibn Ali (mort après 864). D'une famille aristocratique du Sindh, au Sud du Pakistan, convertie à l'Islam, il fit ses études à Bagdad. Astronome, traducteur, mathématicien et ingénieur, il traduisit et modifia le "Zij al-Sindhind", la première table astronomique jamais utilisée dans le monde arabe. Pour ce qui est des mathématiques, Sind ibn Ali était le collègue de al-Khwarizmi, dont il prouva la vérité des travaux et il travailla aussi étroitement avec un autre mathématicien, calculant ensemble le diamètre de la Terre et d'autres corps célestes. Une autre avancée majeure de Sind ibn Ali fut qu'il introduisit la décimale dans le système des chiffres arabes. Il est possible qu'il ait dû enduré la jalousie professionnelle des frères Banu Musa brothers, qui le tinrent éloigné du calife al-Mutawakkil et de sa nouvelle capitale Samarra, au Nord de Bagdad; les frères Banu Musa confièrent aussi à Al-Farghani la construction d'un canal alors que Sind ibn Ali était le meilleur ingénieur de son temps
- Abu-Yusuf Ya'qub ibn Ishaq ibn as-sabbah ibn 'Omran ibn Isma'il al-Kindi (or al-Kindi, Alkindus en latin) (vers 801–873). Savant aux multiples centres d'intérêt, al-Kindi s'intéressa à des domaines aussi variés que la philosophie islamique, la science, l'astrologie, l'astronomie, la cosmologie, la logique, les mathématiques, la musique, la physique, la médecine, la psychologie ou la météorologie; il est également l'un des pères de la cryptologie. Al-Kindi appartenait à la tribu Kinda, une des tribus aristocratiques d'Arabie. Son père était le gouverneur de Koufa. Al-Kindi fit ses études à Bagdad et il devint l'une des figures prééminentes de la Maison de la Sagesse. Plusieurs califes l'y nommèrent pour superviser les travaux de traduction. Nommé par le calife al-Mamun puis par le calife al-Mutasim, son frère (il devint le tuteur des enfants de celui-ci), al-Kindi était réputé pour sa calligraphie magnifique. Il en devint, à un moment, le calligraphe du calife al-Mutawakkil. Cependant, le règne de ce dernier signifia la fin de l'étoile d'al-Kindi. Al-Kindi écrivit au moins 260 ouvrages, important de fortes contributions à la géométrie, la médecine, la philosophie, la logique et la physique. L'oeuvre d'al-Kindi présente la particularité d'avoir une relation étroite avec la philosophie. Appelé le "philosophe des Arabes", ou le "philosophe arabe", la maturation intellectuelle d'al-Kindi fut profondément influencée par la philosophie grecque et hellénistique, qu'il contribua à faire entrer dans le monde arabe. Considéré comme aristotélicien -ou plutôt comme ré-interprétant inconsciemment les textes d'Aristote dans un cadre néo-platonicien de type Plotin ou d'autres écoles philosophiques grecques, il fut également un théologien islamique. Il se fonda sur la compatibilité entre la philosophie et la théologie naturelle et les sciences islamiques orthodoxes et la théologie de l'Islam. Al-Kindi fut l'instrument fondamental par lequel la philosophie devint accessible aux intellectuels du monde arabe (ceux-ci pratiquaient déjà la philosophie des Grecs, surtout la logique). Son importance tient à ce que, via la traduction en arabe de nombreux textes importants, il posa les bases des travaux des philosophes arabes bien connu des époques suivantes, tel al-Farabi ou Avicenne. Jusqu'alors les théologiens arabe méprisaient la philosophie, non à cause de ses méthodes, mais à cause des conclusions erronées en termes de théologie auxquelles elle conduisait. Cette influence de la philosophie voire de la théologie dans l'oeuvre d'al-Kindi l'amena à des vues spécifiques, par exemple, en astronomie, avec cette idée que les corps célestes obéissaient et adoraient Allah ou qu'ils agissaient comme instruments de la divine providence. Nombre de ses ouvrages présentent cette disposition d'esprit, mêlant la science et la religion. En terme de science, al-Kindi insista fortement sur l'expérimentation et la quantification; il réalisa lui-même de nombreuses expériences et des observations, dépassant ainsi ses références grecques, qu'il critique pour leur manque de preuve empirique ou de démonstration des résultats. Un autre aspect de sa méthode consistait à confronter deux explications d'auteurs grecs différents et à ne garder que celle qui était pertinente au fait observé. Bien qu'ayant appartenu à la Maison de la Sagesse sous les règnes de califes favorables au libéralisme intellectuel, al-Kindi, cependant, n'appartient pas à l'école théologique moutaziliste; il attaque même leur croyance en les atomes. Le climat favorable à la culture et aux études du temps fut, ainsi, également favorable à l'entreprise d'al-Kindi. En termes de théologie islamique, les vues d'al-Kindi mènent à une théologie négative très rigoureuse: alors qu'un raisonnement, par exemple, peut s'appliquer à divers objets différents, il ne peut être étendu à Dieu du fait de l'absolue unicité de celui-ci. Il estime compatible le concept aristotélicien de première cause et de premier moteur avec le concept de Dieu selon l'Islam. Al-Kindi estime aussi, contre Aristote, que l'Univers a un passé fini, avec début; il s'insère ainsi dans les doctrines de la création que partagent les trois religions monothéistes du judaïsme, du christianisme et de l'Islam et qui se prononcent contre qu'il existerait un réel infini. Une façon originale de voire est qu'une entité, intellect séparé, incorporel et universel, appelé le "Premier Intellect", a été la première création d'Allah et l'intermédiaire par lequel toutes les autres choses ont été créées; ce concept a à voir aussi avec la question des universaux, al-Kindi se référant au réalisme platonicien. Un concept prônant le détachement des biens matériels et de la matière, la contemplation, la supériorité du spirituel sur le matériel, existe aussi chez al-Kindi, ce qui pourrait peut-être laisser penser à une forme sous-jacente d'influence boudhiste, sinon stoïcienne. En ce qui concerne son oeuvre scientifique, al-Kindi, en termes de chimie, fut le premier à s'opposer à l'alchimie, démontant le mythe de la transmutation de métaux vils en or ou en argent et il fut le premier à isoler l'éthanol, l'alcool distillé du vin. On considère aussi al-Kindi comme le père de l'industrie du parfum. Son "Ketab fi Isti'mal al-'Adad al-Hindi" ("Sur l'utilisation des chiffres indiens") contribua grandement à la diffusion du système numérique indien au Moyen-Orient et en Occident. En géométrie, parmi d'autres ouvrages, il écrivit la théorie des lignes parallèles. On a aussi deux livres sur l'optique. En météorologie, il réalisa une expérience en laboratoire pour prouver que l'air se transforme en vapeur. En médecine, il utilisa les mathématiques et des méthodes quantitatives, particulièrement dans le domaine de la pharmacologie. Al-Kindi fut aussi le premier grand théoricien de la musique dans le monde arabe, y utilisant pour la première fois le mot "musiqia", "musique" en arabe. En psychologie, il écrivit, par exemple, sur le chagrin, qu'il décrit comme la douleur spirituel causée par la perte d'êtres chers ou de biens personnels ou l'échec à obtenir ce que l'on désire. Al-Kindi pourrait bien avoir quelque chose d'un Scot Erigène du monde arabe de cette époque car, malgré certaines précautions, il aboutit à une approche très naturaliste de la religion, allant jusqu'à expliquer les visions et prophéties par des mécanismes biologiques
Une raison à l'abandon de l'ijtihad?
Pour les premiers juristes et les premiers interprétateurs de la tradition, les situations concrètes ont joué un rôle. Malgré une tendance évidente à l'artifice et à une intelligence apte à se mouvoir dans un formalisme -sans toutefois être bien apte à réfléchir sur un point précis, ils prirent en compte les transformations qu'avait induites la conquête, qui avait fait passé l'orbe des Musulmans de l'Arabie à un monde plus vaste. Un tel dynamisme permettait, et permit, adaptation et assimilation. Par ailleurs, ces érudits, dans leurs écrits -par instinct de protection? Par coutume profondément ancrée?- ont évité d'énoncer les références au réel par lesquelles ils prônaient ces évolutions: ils évoquent des traditions ou se rapportent aux versets du Coran. La conséquence -importante- en a été que leurs sucesseurs, lorsqu'ils utilisèrent leurs oeuvres, ne virent que ce rattachement à la tradition et pas l'esprit innovateur. Aussi, se contenter de commenter leurs maîtres à leur tour leur sembla-t'il justifié et ils ne poursuivirent ni ne développèrent les méthodes permettant l'évolution de la tradition. On a sans doute là l'origine de la fermeture si aisée de l'ijthidad sans protestations ni incartades. Les successeurs étaient tombés dans l'abandon de toute initiative
Website Manager: G. Guichard, site Learning and Knowledge In the Carolingian Times / Erudition et savoir à l'époque carolingienne, http://schoolsempir.6te.net. Page Editor: G. Guichard. last edited: 6/30/2016. contact us at geguicha@outlook.com