
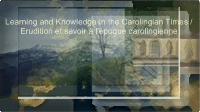
 | un érudit travaillant à l'Ecole Palatine |
(les écoles sont classées par époque chronologique et, dans chaque catégorie, par ordre alphabétique. NB: cette page ne doit pas être considérée comme terminée; les notices peuvent être augmentées ou de nouvelles notices être créées)
On notera que, d'une façon générale, l'oeuvre de collecte, de copie et de diffusion des oeuvres profanes et religieuses par l'Ecole palatine contribua grandement à la mise en relation des différentes écoles monastiques et cathédrales de l'Empire carolingien. Il semble cependant que cette impulsion était nécessairement centralisée, le mouvement se faisant des écoles locales vers la cour et inversement, même si, dans certains cas, la proximité des abbés de grandes abbayes de l'Empire d'avec le milieu des érudits de la cour -ainsi à Lorsch, par exemple- dut tendre à rendre ces échanges plus égalitaires. Des relations plus "horizontales" semblent avoir également existé. Il semble en effet que les clercs de l'époque n'hésitaient pas à pratiquer des "voyages d'étude" -pour aller consulter, plus ou moins loin, pour leurs travaux, les manuscrits d'une autre école- ou à se faire prêter ces manuscrits. Une autre cause de relations -plus localisées- entre écoles monastiques pouvait aussi tenir au rôle important, en matière ecclésiale, d'un prélat qui, par exemple, avait pour charge de redonner un rôle à divers monastères de son évêché -ainsi Etienne à Liège, vers 900. Des relations proches ou plus lointaines pouvaient être dues aussi, pour une grande part, aux relations maintenues entre maîtres et élèves voire condisciples. D'autres causes peuvent avoir aussi joué. Enfin, le fait que Charlemagne a continué la politique des premiers Carolingiens de placer des Austrasiens dans les différents territoires du royaume et de l'Empire fit que l'on verrra souvent des liens de longue durée entre ceux-ci. Ainsi, entre la Gaule et l'"Allemagne", par exemple
. Prüm, en Allemagne, fondée par Pépin le Bref à l'instigation de la reine Berthe qui voulait en faire un centre de diffusion de la culture franque en Germanie
. Echternach, en Allemagne, possédait un scriptorium qui, dès le VIIIème siècle, produisait des manuscrits liturgiques et avait une vie intellectuelle intense
. Auxerre, France (nord-ouest de la Bourgogne): l'école monastique de St-Germain d'Auxerre, l'abbaye qui contenait les reliques de St Germain, avait une réputation qui s'étendait dans tout l'Occident carolingien. Elle jouit de la faveur de l'empereur Charles le Chauve (843-877). Entre 840 et 890, Auxerre devient l'un des deux ou trois centres culturels principaux de l'Empire. Le premier maître est Murethach, un grammairien irlandais (peut-être au fait de la légende de St Germain maître de St Patrick en Angleterre). L'un des acteurs de l'école fut sans doute Loup Servat, abbé de Ferrières-en-Gâtinais (840-862), connu pour ses activités philologiques et rassemblant de nombreux manuscris qu'il fit copier. Plusieurs ouvrages composés par des maîtres de l'école furent largement diffusés dans les grands centres intellectuels carolingiens. Une relation forte, datant de Charles Martel, existait entre St-Germain d'Auxerre et la Bavière. L'évêque Héribald (829-857), un des maîtres d'Auxerre, avait des liens avec Raban Maur, établissant des échanges de manuscrits ou de reliques. St-Germain d'Auxerre est "l'autre" pôle de l'Empire carolingien. 4 maîtres se sont succédés à la tête de l'école monastique entre 835-840 et 893, tous, d'abord, élèves à l'école: Murethach (Irlandais, grammairien; quitte Auxerre pour Metz vers 840-845, s'installant dans l'entourage de Drogon; a donné un cours de grammaire -c'est un commentaire de la grammaire la plus utilisée à l'époque: l'"Ars Major" de Donat; il y développe l'explication des mots et des constructions par un système de questionnement; il est peut-être venu à Auxerre du fait de la légende selon laquelle St Germain aurait été le maître de St Patrick en Angleterre); Haymon (élève du précédent; maître de l'école vers 840-845/860, exégète biblique; s'appuie sur les oeuvres de Servius ou Isidore de Séville pour fonder, déjà, la vision de la société en trois ordres fonctionnels: ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent); Heiric (oblat en 848, suit l'enseignement de Haymon et est son disciple; il est élevé au monastère en même temps que Lothaire, fils de Charles le Chauve. Il suit ensuite l'enseignement de Loup de Ferrières puis l'école de Soissons; prêtre en 865; une vie de St-Germain et récit des miracles du saint; il commente les classiques de la théologie latine; meurt vers 875-885; marqué à Soissons par les écrits novateurs de l'helléniste Jean Scot Erigène, le promoteur des auteurs néo-platoniciens en Occident, oubliés du fait de l'oubli du grec; diffuse les idées néo-platoniciennes via Maxime le Confesseur ou le Pseudo-Denys; est familier de gloses sur des textes en cours d'études avec ses élèves; Rémi (le dernier maître de l'école; sa renommée le fit appeler à Reims puis Paris, où il eut Odon, le futur abbé de Cluny, comme disciple; théologien, commentaires grammaticaux et commentaires d'auteurs antiques; a aussi composé des commentaires grammaticaux de constructions en prose ou en vers à partir de Phocas, Priscien, Donat, tous auteurs de la fin de l'Antiquité; le départ de Rémi marque la fin de l'importance d'Auxerre). L'école se distingue aussi par son intérêt pour les sciences et notamment la géographie (les auteurs antiques sont, là encore, leurs modèles). Heiric a peut-être écrit un traité de géographie -le "De situ orbis"- dédié à Charles le Chauve dans lequel il réfléchit sur les routes utilisées par les Vikings et Rémi est l'auteur d'une "Lettre sur les Hongrois" par laquelle il recherche les racines de ceux-ci. En matière théologique, Haymon et Rémi ne se limitent pas à compiler mais ils ajoutent d'abondantes notices érudites et l'explication des termes ayant un intérêt doctrinal ou historique. Les deux auteurs composèrent également des homéliaires, recueils pour guider la méditation des moines et des fidèles, s'inspirant des lectures du jour et en proposant des exposés et des commentaires
. Bobbio, Italie (près de Gênes): Bobbio fut fondé en tant que monastère en 614 par St Colomban. Elle devint un centre de transition vers le catholicisme pour les Lombards et fut très rapidement un centre important de culture. La bibliothèque de Bobbio commença avec les manuscrits que Colomban avait apportés d'Irlande et avec les traités du saint et put se maintenir à travers divers troubles qui ne se calmèrent qu'à l'époque de Charlemagne. La bibliothèque fut augmentée du don que fit St Dungal de sa bibliothèque de 70 volumes. St Dungal était l'un de ces Irlandais qui avaient toujours eu de l'affection pour cette abbaye fondée par l'un des leurs et qui venaient s'y installer
. Chartres, France: données manquantes
. Corvey, Allemagne (près de Paderborn, en Westphalie): l'abbaye bénédictine fut fondée en 820 par Louis le Pieux en tant que "Nouvelle Corbie". St Adelhard, le neuvième abbé de Corbie, avait participé à sa fondation. L'école de Corvey produisit de nombreux érudits célèbres et c'est à l'abbaye que Widukind écrivit son Histoire des Saxons. L'abbaye fut également le point de départ de l'évangélisation de l'Europe du Nord
. Fécamp (?), France: données manquantes
. Ferrières, France (près d'Orléans): devint un centre littéraire relativement actif sous l'abbé Loup de Ferrières, vers 850
. Flavigny, France (à Flavigny-sur-Ozerain, en Côte d'Or, juste à l'Est du site d'Alésia): abbaye bénédictine fondée, sous le vocable de St Prix, évêque de Clermont, en 719-722 par une donation de Wideradus (Guiré), noble burgonde -qui était déjà abbé à titre de précaire d'Alise, de la basilique St-Andoche de Saulieu et de celle de St-Ferréol de Besançon. Dès le début, l'abbaye devient un haut lieu de culture notamment par son scriptorium qui produit quelques-uns des plus beaux manuscrits du VIIIème siècle. Ce sera aussi à Flavigny, au milieu du déclin de l'époque, que seront augmentés et mis au point les livres liturgiques envoyés de Rome à la demande de Pépin le Bref. Au-delà de la richesse de l'ornementation, apparaît une écriture nette, que l'on appelle "écriture de Bourgogne". Guérin, comte de Mâcon et premier entre les Grands de Bourgogne, s'intitule "recteur de Flavigny" vers 835, signe qu'il règne aussi sur l'Auxois. L'abbé Egilon, au IXème siècle, en 865, prenant prétexte des menaces normandes, fait chercher dans le village proche d'Alise les restes de Ste Reine, martyre de la fin de l'époque romaine, et les abrite dans une nouvelle abbatiale. Cette nouvelle église est bâtie selon le modèle de St Germain d'Auxerre (Flavigny, à cette époque, est en relations étroites avec l'école d'Auxerre et avec le pouvoir impérial). Le pape Jean VIII vient la consacrer au printemps 878 (il reçut 8 livres d'anis -l'abbaye St-Pierre produisait sans doute déjà des dragées à l'anis, ancêtres des bonbons modernes- mais, dans une lettre, il se plaignit qu'on lui avait volé sa petite coupe d'argent). Flavigny, qui trouve son origine de Flavinius, légionnaire romain qui fut doté d'une terre après la guerre des Gaules, conserve encore sa crypte carolingienne. Flavigny possédait, en contrebas, un des plus anciens vignobles de France (il aurait existé dès l'époque d'Alésia); Charlemagne aurait dégusté, en 741, une bouteille de Flavigny. La petite ville, de nos jours, contient encore la crypte carolingienne de l'abbaye -crypte de Ste-Reine- à deux niveaux, dont les parties les plus anciennes datent du VIIIème siècle
. Fleury, France (près d'Orléans): (aujourd'hui St-Benoît-sur-Loire). Importante abbaye bénédictine, fondée vers 651. Par un subterfuge, on y amena le corps de St Benoît, qui fut dérobé au Mont Cassin. L'histoire de l'abbaye, à l'époque carolingienne, se mêle avec celle du diocèse d'Orléans, dont le titulaire était Théodulfe. voir à Orléans
. Fulda, Allemagne (au nord-est de Francfort-sur-le-Main): voir la page consacrée à l'abbaye
. Laon, France. Il y eut une tradition irlandaise (on disait aussi "Scots" -Ecossais) de longue date dans cette école. On fait état, ainsi, de missionnaires irlandais -ermites- dès le VIème siècle dans l'évêché de Laon puis du développement rapide de monastères, tous irlandais et colombaniens. Mais l'influence irlandaise devient surtout remarquable sous les évêques Pardule (848-856) et Hincmar le Jeune (858-871), mais aux érudits irlandais de vers 850-875 (Scot Erigène; Martin Scot -819-875), succèdent des érudits germaniques en 875-900 (Mannon -sans doute successeur d'Erigène à la tête de l'Ecole palatine de Charles le Chauve, Bernard -l'évêque de Laon, Didon, jouant un rôle actif auprès de ces derniers). Une troisième génération (900-930, Adelelm -ou Alleaume, doyen du chapitre puis évêque; il était probablement l'élève de Bernard) apparaîtra aussi, existant de concert avec la précédente. Tous ces érudits sont liés à la fois à l'Ecole palatine sous Charles le Chauve, à la cathédrale de Laon et à l'abbaye colombanienne de St-Vincent de Laon. L'influence irlandaise reprendra au milieu du Xème siècle avec un moine irlandais, Mac-Allan, prenant en 961 la tête des abbayes St-Vincent de Laon et St-Michel en Thiérache. L'activité du scriptorium de Laon et la renommée de l'école cathédrale demeureront importants jusqu'au moins au XIème siècle
. Lorsch, Allemagne (près de Worms): située à 16 km à l'Est de Worms, l'abbaye de Lorsch fut fondée en 764 par le comte Cancor -d'une veille famille franque de Neustrie dont la ligne se perpétua jusqu'aux Robertiens qui fondèrent les premiers Capétiens- et sa mère, Williswinde, qui était devenue veuve. Ils firent construire un monastère et une église -tous les deux en bois- sur leur domaine de Laurissa (d'où Lauresham, puis Lorsch), qu'ils confièrent aux soins de Chrodegang, évêque de Metz et parent du comte et de sa mère. Celui-ci dédia les deux bâtiments à St Pierre Apôtre et en devint le premier abbé jusqu'en 766. Chrodegang était un familier de Pépin le Bref et l'un des plus importants responsables de la réorganisation de l'Eglise franque. L'abbaye, entre-temps, avait encore été augmentée, par les fondateurs, de donations supplémentaires. Gundeland, frère de Chrodegang et 14 moines bénédictins venus avec lui de Görze prirent la suite en 766. Les reliques de St Nazaire -un martyr de l'époque de Dioclétien- avaient, depuis juillet 765, été envoyées à l'abbaye par le pape Paul Ier, Lorsch devenant la première abbaye du monde franc à recevoir les reliques d'un saint romain. L'abbaye devint ainsi un centre de pélerinage. L'abbaye et l'église -qui était devenue basilique- furent renommées en l'honneur de St Nazaire. Les miracles opérés par les reliques du saint augmentèrent la renommée de l'abbaye et son école devint un centre d'érudition et de culture, l'abbaye devenant l'une des plus importantes de l'Empire, tant sur le plan spirituel que sur le plan culturel. Elle possédait l'une des plus importantes bibliothèques de l'Empire franc. Ce fut Richbod, le quatrième abbé, qui développa, à partir de vers 775, le scriptorium, puis l'école monastique. Richbod, sous le nom de 'Macharius', appartenait au cercle des érudits de la cour, autour d'Alcuin et Charlemagne et il avait été formé par Alcuin. En tant que membre du cercle des élites du royaume, Richbod vit ainsi l'abbaye de Lorsh prendre non seulement une part importante dans l'oeuvre de collecte, copie et diffusion des ouvrages anciens, laïcs et ecclésiastiques mais aussi dans la réforme de l'enseignement dans le royaume voulue par Alcuin. Les nombreuses possessions de Lorsch s'étendaient de la mer du Nord à la Suisse. Lorsch, aujourd'hui, est célèbre pour son entrée-porche, un des restes de l'abbaye -dite aussi la "Königshalle". C'est l'un des restes architecturaux pré-romans les plus importants d'Allemagne. Lorsch, par une requête du fils du fondateur à Charlemagne, était devenue immédiate à l'empire et avec immunité, la plaçant ainsi hors des prétentions des féodaux locaux. L'abbaye, comme les autres abbayes de l'empire, devait l'ost et devait se préoccuper de coloniser les terres avoisinantes. Selon un schéma qui dut être habituel, l'abbaye de Lorsch commença d'être une fondation privée pour devenir une abbaye de l'empire. Les moines n'y priaient plus seulement pour les fondateurs mais aussi pour l'empereur et l'Empire. Depuis 774, par ailleurs, une résidence royale avait été bâtie à Lorsch; elle fut fréquentée par Charlemagne puis Louis le Germanique
. Metz, France (Lorraine): Metz, avec Arnoulf et Pépin de Landen, est le berceau de la dynastie carolingienne. La ville fut aussi une nécropole familiale: la reine Hildegarde ou Louis le Pieux y sont enterrés. Du fait que ses évêques furent des proches de la famille royale ou impériale, Metz devint un centre liturgique et théologique. Chrodegang fut nommé par Pépin le Bref pour y réformer le clergé et rédiger une règle pour les chanoines; le rituel romain fut adopté à Metz dès 755, étape de l'unification religieuse voulue par Charlemagne. Angilram, chapelain de Charles, fut le premier à écrire une révision de la Bible. Il créa aussi un scriptorium pour la cathédrale. Paul Diacre devait y écrire, à sa demande, la "Gesta episcopum Mettensium", oeuvre qui retrace l'histoire des évêques de la ville et de la dynastie carolingienne. En 821, Louis le Pieux nomma évêque Drogon, un fils illégitime de Charlemagne -et donc son demi-frère. Charles le Chauve, en 869, choisit Metz pour lieu de son couronnement comme roi de Lotharingie et, à cette occasion il fit don d'un psautier et d'une Bible à la cathédrale. Y avait-il une école à Metz? Metz en tout cas, à la moitié du IXème siècle était un centre brillant en termes d'enluminure et de sculpture de l'ivoire
. Orléans, France : une école cathédrale? L'évêché, depuis 798, est assuré par Théodulfe, un Wisigoth qui, depuis 780, a participé, à la cour, à la vie intellectuelle et aux grands débats théologiques. Théodulfe a également été abbé de Fleury. Il succède à Alcuin en 804. Emprisonné en 818 à Angers, où il finit ses jours, pour cause qu'il a pris le parti de Bernard d'Italie contre Louis le Pieux. L'activité du scriptorium rejette la figuration, conformément aux positions prises par Théodulfe dans la querelle de l'iconoclasme
. Pavie, Italie (Italie du Nord): Pavie, en tant que capitale du royaume lombard, eut toujours des "écoles de grammaire". Ces écoles étaient réputées à l'époque de Charlemagne, qui y prit le grammarien Pierre de Pise. Lothaire finit par y créer une école "centrale" -une Ecole palatine- en 825, dirigée par l'Irlandais Dungal. Pavie était restée capitale du royaume d'Italie après la défaite des Lombards
. Reims, France: la ville du baptême de Clovis et du sacre des rois de France pourrait avoir eu des écoles canoniales dès l'époque carolingienne. Les scriptoria se répartissent entre la cathédrale et le monastère de St-Rémi de Reims et les monastères St-Thierry et d'Hautvillers. L'apogée de Reims est atteint sous l'abbé Ebbon, frère de lait et bibliothécaire de Louis le Pieux; Ebbon veut faire de Reims le centre nouveau de la Renaissance carolingienne (il fait, par exemple, édifier la cathédrale, ou rassemble des artistes au monastère d'Hautvillers); il est exilé à Fulda en 835 pendant les luttes entre Louis le Pieux et Lothaire; définitivement destitué en 841 par Charles le Chauve, se réfugiant près de Louis le Germanique, auprès de qui il obtient le siège de Hildesheim. L'apogée, cependant, se maintient sous son successeur, Hincmar. Evéque et abbé de St-Rémi, ancien moine de St-Denis et familier de la cour, Hincmar prend part aux querelles théologiques sur la prédestination et la Trinité
. Rouen (?), France: données manquantes
. St-Amand, France (St-Amand-en-Pévèle puis St-Amand-les-Eaux; 20 km au Sud de Tournai): abbaye royale est considérée comme le centre de l'"école franco-saxonne". Une école? Le scriptorium, très actif à la fin du VIIIème siècle, est spécialisé dans des livres liturgiques de luxe destinés à de hauts dignitaires, au roi ou à d'autres établissements religieux. Le scriptorium mêle les motifs anglo-irlandais aux apports strictement carolingiens. Sur le plan artistique, le style "franco-saxon" se perpétuera au-delà de l'époque carolingienne, ouvrant la voie à l'art roman
. St-Denis, France (Nord de Paris): abbaye immédiate au pape et au roi dès le milieu du VIIème siècle, St-Denis bénéficie d'une relation particulière aux Carolingiens depuis le sacre de Pépin le Bref en 754. Son école est en relation constante avec les autres abbayes de l'empire. Elle bénéficie de donations royales d'objets et de manuscrits, en particulier sous Charles le Chauve
. St-Martin de Tours, France (Tours): l'abbaye, bénédictine depuis le VIIè siècle, abrite les reliques de Saint Martin. Des scribes irlandais s'y installent au VIIIème siècle. C'est surtout Alcuin qui développe le scriptorium. L'apogée de celui-ci a lieu sous l'abbé Vivien et la renommée en est telle que l'on lui confie des commandes impériales. L'activité décline après le pillage du monastère par les Normands en 853. Une école?
. St-Quentin (?), France: données manquantes
. St-Riquier, France (Picardie, près d'Abbeville; c'est l'ancienne Centule): reconstruite, l'abbaye de St-Riquier, sous Angilbert, commence de possèder une importante bibiothèque. Angilbert est l'élève et l'ami d'Alcuin et il est ambassadeur auprès du pape Hadrien Ier puis Léon III. Il est aussi le compagnon de Berthe, l'une des filles de l'empereur
. Soissons, France: données manquantes
 | cliquez pour une carte des écoles carolingiennes |
. Celle, Allemagne (Basse-Saxe): données manquantes
. Hirschau, Allemagne (Bavière, près de Cawl, en Forêt Noire): Noting, évêque de Verceil, apporta en 830 les reliques de St Aurelius (mort à Milan en 475); il était le parent d'Erlafried, comte de Cawl. Il y fonda une chapelle et aussi une église dédiée à St Nazaire. Le lieu devint le centre d'une abbaye, des moines y étant venus de Fulda, sous la direction de l'abbé Lutbert (mort en 853). En 988, l'abbaye est ravagée par la peste et la famine; des dissensions, de plus, avaient affecté l'abbaye. Celle-ci, en 1001, passera au comte de Cawl
. Hirsfeld (ou Hersfeld), Allemagne (au confluent de la Geisa et de la Fulda): abbaye impériale bénédictine, relevant du diocèse de Mayence. Lul, archevêque de Mayence, disciple de St Boniface, fonde l'abbaye en 769 car il ne peut s'assujetir celle de Fulda (une abbaye immune depuis 751); le lieu avait déjà été repéré par Sturmius mais jugé trop près des Saxons). Hirsfeld devient rapidement une des abbayes les plus prospères de Germanie. Elle fut largement dotée par Charlemagne, avec privilèges et possessionée aussi en Hesse et en Thuringe. Sa notoriété s'accrut lorsqu'elle reçut les reliques de St Wigbert, abbé de Fritzlar (?) puis celle de Lul même. Une imposante église abbatiale fut construite en 850. Un des premiers abbés fut Haymon, qui, ensuite, devint évêque d'Halberstadt en 841. Hirsfeld fut très vite renommée pour son observance de la règle bénédictine ainsi que pour sa vie intellectuelle (l'abbaye a commencé les Annales Hersfeldienses). Elle possède une école monastique, qui est mentionnée par Loup de Ferrières dans la Vita S. Wigberti et elle atteindra son apogée sous l'abbé Gosbert; elle restera très active ensuite. On y trouvait de précieux manuscrits. Une forme de relâchement a lieu sous l'abbé Bernard, à la fin du Xème siècle, qui se comporte en féodal mais elle connaîtra aussi des périodes de redressement
. Petersburg, Allemagne?: données manquantes
. Reichenau, Suisse: l'abbaye bénédictine, fut fondée par St Permin sur une petite île du lac de Constance (entre les actuelles Allemagne et Suisse), sur la suggestion de Charles Martel. Elle devint une abbaye importante bien avant que St-Gall n'atteigne son plein développement. Reichenau était située sur les routes des pélerins et des voyageurs vers l'Italie et des Irlandais, des Italiens et même des Grecs apportèrent des reliques, ainsi une croix avec du sang du Christ dont on dit qu'elle avait été donnée par un Arabe à Charlemagne et qu'elle aurait été ensuite confiée à l'abbaye en 925; ou les reliques de St Marc apportée de Venise en 830. L'empereur Charles le Gros est enterré à Reichenau. Walafrid Strabo et Hatto sont des élèves de Reichenau. Eux et d'autres formèrent la bibliothèque de l'abbaye et son école de peinture. Reichenau joua un rôle fondamentale, dans la renaissance ottonienne, en termes d'enluminures et de manuscrits
. Rheinau, Suisse: données manquantes
. Solenhaufen, Allemagne?: données manquantes
. St-Gall, Suisse: St-Gall, près de la rive sud du lac de Constance (actuelle Suisse), fut d'abord le lieu de sépulture de Gallus -St Gall- mort en 646, compagnon de St Colomban. A l'instigation de Charles Martel et avec la protection de Pépin le Bref, l'endroit se transforma en abbaye et adopta la règle bénédictine. Dès cette période, l'érudition et la copie de manuscrits y étaient développées. La bibliothèque fut aggrandie de façon importante sous l'abbé Gotzbert (815-837) et les moines copiaient les manuscrits les plus récents. Notker le Bègue, deux autres Notker, Eckhard et Harker étudièrent à St-Gall. L'abbaye fut une école importante de chant grégorien. St-Gall est célèbre pour son plan, conservé, qui aide à bien réaliser ce qu'était une grande abbaye carolingienne. Le site CESG, Codices Electronici Sangallenses met en ligne les manuscrits conservés par l'abbaye; un site intéressant (le français est la langue la moins bien dotée du site)
. Liège, Belgique: la ville devint célèbre lorsqu'y fut édifiée une basilique abritant les reliques de St Lambert, évêque qui avait achevé la difficile conversion des Francs de la région et qui avait été tué par des seigneurs locaux en 705. Liège remplaça alors Tongres comme siège épiscopal. L'école de Liège est modeste au début mais le passages d'érudits proches de la cour -ainsi Sedulius Scottus vers 850, avec Dermoth, Fergus, Blandus, Marcus et Bentchell- rendent l'école prestigieuse. Liège a alors une colonie de maîtres irlandais sous le règne de Lothaire (840-855). Ces périodes de prestige, liés à une personnalité, cependant, ne durent pas. C'est, en fait, surtout à partir du début du Xème siècle qu'émergent nettement des écoles -au pluriel- à Liège, dont l'école cathédrale St-Lambert. Elles naissent des rapports d'érudition qui s'établissent entre la cathédrale de Liège et le monastère de Lobbes mais se sera surtout à la fin de l'époque carolingienne -après 950-960- que les écoles deviennent prospères et réputées. L'impulsion donnée, vers 900, par Etienne, évêque, tient à ce que le prélat, apparenté à la dynastie carolingienne et à la haute aristocratie franque, a été formé, à l'Ecole palatine de Charles le Chauve, auprès de Mannon, puis Robert, évêque de Metz (883-917). Robert était lui-même soit un condisciple, soit même l'élève de Notker le Bègue (vers 840-912), à l'école de l'abbaye de St-Gall. Notker, à la fois poète, hagiographe et biographe, "musicologue" et liturgiste, transmit ces aptitudes à Robert, qui les transmit à Etienne. L'école de Liège, vers 900, alors que cette partie de la Lotharingie est rattachée à la Francie Occidentale, devient, par Etienne, une sorte de pont intellectuel qui apporte à la partie occidentale de l'Empire les connaissances du monde germanique. Etienne sera surtout hagiographe et liturgiste. Il occupe le siège de Liège de 901 à 920. Il est l'auteur d'une vie de St-Lambert, autre évêque de Liège. L'aura de l'école, et surtout d'Etienne, à cette époque voire par la suite, tiennent sans doute au fait que l'évêque était apparenté aux Carolingiens
. Les écoles de l'époque carolingienne se perpétuèrent pendant les temps sombres et pendant la première moitié du XIème siècle. Alors que l'Europe était en déclin, Liège demeura un centre renommé de littérature et d'art
. St-Laurent, Belgique?: données manquantes
. Utrecht, Pays-Bas: Utrecht devint le siège d'un évêché fondé par St Willibrord en 695, lorsqu'il évangélisait les Frisons. St Willibrord fonda également une école épiscopale qui devint un important centre d'éducation pour la partie septentrionale du royaume franc
. Corbie, France (Picardie, près d'Amiens): abbaye bénédictine, fondée entre 657 et 661 comme abbaye royale, Corbie devient le plus important monastère du Nord de la Gaule et, sous Charlemagne, elle devient un foyer d'étude remarquable, sous l'abbé St Adelhard. Sa bibliothèque contient aussi bien les livres fabriqués sur place qu'acquis, échangés ou prêtés. L'abbaye, sous Maurdramne (772-781) joue un rôle important dans la naissance et la mise au point de la caroline
. Paderborn, Allemagne (Sud de Hanovre): Paderborn a eu une école épiscopale depuis l'époque de St Badurad (815-862). La première église de Paderborn fut construite en 777 lors d'une diète tenue là par Charlemagne. La ville était déjà siège d'un évêché en 805-806