
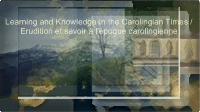
Les Francs, quand ils sortent de Germanie, parlent le francique. On dit francique, francisque et aussi théotisque, théodisque, tudesque puisque les Francs appartenaient à la grande famille des "tudesques", des peuples germaniques. On désignait par Tudesques, ou Teutons, les peuples germaniques qui, au cours des migration depuis la Scandinavie, jusqu'au IIIème siècle de notre ère, s'étaient installés dans l'actuelle Allemagne, du Rhin à la Vistule et au confluent de la Morava et du Danube et de la mer du Nord et de la Baltique aux limites de l'Italie; seule une partie de ces peuples étaient restés en Scandinavie, tels les Goths, Suèces, etc. La langue des Germains, en Scandinavie, n'était qu'une et elle se divisa en deux branches lors de la migration. Augmentés des peuples, comme les Sicambres, qui se joignirent à eux en une confédération de peuples, les Francs passent en Gaule et s'y installent, une partie, les Francs ripuaires, restant installés dans leurs régions d'origine, vers le Rhin des alentours de Cologne, Mayence et Francfort. Ils apportent donc leur langue avec eux et, au moins jusqu'aux débuts des Capétiens, les rois, les seigneurs, les soldats et les libres francs vont continuer de la parler. Et, encore sous Charlemagne, le moine Otfride, disciple de Raban Maur, continue d'appeler la langue franque via tous les vocables que l'on vient d'évoquer ci-dessus. A l'époque mérovingienne, il est possible que les Francs saliens, implantés hors du vieux territoire franc, aient déjà plus ou moins, commencé de perdre un peu de leur originalité aux milieux des peuples gaulois parmi lesquels ils vivaient mais il est cependant aussi possible que l'intérêt soutenu des Francs mérovingiens pour les pays allemands, considérés comme une zone naturelle d'influence ainsi que pour l'Austrasie, à qui ils donnent vite des souverains autonomes, leur ait permis de maintenir fortement leurs racines germaniques. Pour ce que est des Carolingiens, on connaît le goût de Charlemagne pour tout ce qui relevait de sa culture nationale, celles des Francs ripuaires, des Francs d'Austrasie, y compris la langue et le costume
Charlemagne est également célèbre car il fit rédiger par écrit toute l'antique culture germanique, celle qui venait des premiers Germains et qui, à travers les âges, chantait les exploits des héros, des chefs et des guerriers. Les chants épiques germaniques se rattachent surtout à la période qui va du IIème au VIème siècle de notre ère, période de changement et de destructions au cours de laquelle les Germains ostiques et westiques changèrent de territoires et période qui comprend aussi l'époque de la chute de l'Empire romain. Déjà, sous Tacite, les Germains chantaient Arminius, celui qui à Teutoburg, avait exterminé les légions de Rome, plus ou moins déifié et son fils Mann, qui était considéré comme ayant fondé la nation germanique. Ces anciens textes, des chants épiques, à l'époque de Charlemagne, tendaient à se perdre car ils n'étaient qu'une littérature orale et l'ancienne langue germanique avait désormais tendance à se perdre. Charlemagne connaissait par coeur ces anciennes sagas. La volonté de Charles de donner une grammaire claire au francique participe du même esprit. La collection écrite que Charlemagne compila de cette ancienne littérature des Germains s'est perdue. Certains pensent qu'elle fut brûlée sur ordre de Louis le Pieux, car trop proche du paganisme (cependant, ce souci de rappeler les actions passées sera repris par le Concile de Francfort, qui se prononce sur Nicée II et l'inclut dans le rôle esthétique et pédagogique de l'image. S'y mêle aussi, selon la logique que l'Ancien Testament annonce le Nouveau, des conquérants anciens (Cyrus, Ninus, Alexandre, Hannibal) préfigurant les nouveaux (Constantin, Théodose, Charles Martel, Pépin, Charlemagne). L'histoire, telle que connue par les auteurs de l'Antiquité, par ce rôle, se trouvait valorisée). D'autres pensent que tout ou partie de l'oeuvre, par exemple, aurait pu atteindre les Minnesänger, ces trouvères allemands et Wolfram d'Eschenbach, trouvère des XIIème et XIIIème siècles, dit utiliser un "ancien livre" qui aurait pu être la collection de Charlemagne. Il y puisa les "Voyages par mer de l'empereur Otnit" et "Les aventures de Weigand Dietrich et celles de son fidèle Meister Hiltebrand". Il est possible aussi, que sur la couverture d'un manuscrit latin du VIIIème ou du IXème siècle, le fragment d'un combat raconté en langue francique ait aussi appartenu à la collection de Charles. Pour Charlemagne, le francique était la "langue de ses pères". Il écrivait son nom avec un "K", lettre propre au francique et le monogramme de Charles porta toujours ce K
Le francique est toujours la langue de Louis le Pieux (qui parlait aussi le grec et le latin). Le Serment de Strasbourg est en francique et en roman et, au milieu du Xème siècle, on est encore obligé de traduire un discours latin en francique, en 948, pour qu'un roi le comprenne. Le projet de grammaire, entrepris par Charlemagne avec Nannon, Théobald, Alcuin et Bérenger fut finalement abandonné du fait d'autres tâches et on ne la reprit pas après la mort de Charles. Un moine, cependant, Otfride, disciple de Raban Maur, poursuivit ce travail, ses travaux en prose et en vers, de plus, attestant qu'il connaissait les règles du francique. Selon Otfride, Charlemagne aurait également inventé d'"autres alphabets" dont il se servait pour correspondre "avec les préfets des provinces dans son vaste empire". Certains fragments de la "Grammaire francique" d'Otfride ont été publiés anciennement et Otfride avait conservé des fragments de ces autres alphabets. Raban Maur, lui, a composé des glossaires franciques, selon l'usage d'un temps où il fallait, pour les divers usages du gouvernement ou de l'Eglise, que les officiels et les clercs pûssent exprimer dans la langue de leurs administrés des textes ou des concepts rédigés en latin. Les poésies franques aiment l'allitération -qui est une invention franque, c'est-à-dire l'uniformité des lettres initiales dans les mots qui présentent les idées principales du même vers et les Francs furent les premiers à avoir employé la rime, l'uniformité dans les sons des syllabes qui terminent deux vers correspondant l'un à l'autre. L'allitération n'a pas survécu au siècle de Charlemagne car elle est peu favorable au mouvement naturel de la versification. La rime, au contraire, s'est étendue à tous les peuples d'Europe
Les intellectuels de la Renaissance carolingienne avaient pris des noms de terminaison latine et ils écrivaient en latin quoique leur langue maternelle ait été le francique. Selon l'usage des Grecs et des Romains, ils appelait le francique une langue "barbare". Mais les conciles provinciaux de 813 insistent sur la nécessité de prêcher dans les langues réellement "vivantes" du temps. Ceux de Mayence ou Reims disent qu'il faut prêcher selon "la propriété de la langue" dont se sert le peuple afin qu'il puisse comprendre le sens de la parole divine. Ces langues vivantes, ainsi, peu de temps avant la mort de Charles, y compris dans la région de Tours, loin des terres germaniques, sont la "langue rustique romane" pour le peuple et la "langue théodisque" pour les Francs. Ces dispositions se retrouvent au concile de Mayence de 847. Encore dans un capitulaire de 829, de Louis le Pieux, une institution, la dissolution du ban au retour de l'ost du comte avec ses soldats, se voit rappeler son nom francique: "le ban sera dissous pendant 40 jours, ce que l'on appelle en langue théodisque, "scatlegi" ou "repos d'armes"". Jusque tard, enfin, sous les Capétiens, vers 1200, se maintint encore un fort vocabulaire et des noms de famille et de lieu francs, le vocabulaire finissant par participer à la synthèse qui mènera, via la Renaissance, à la langue française contemporaine. Le francique commença, en termes d'implantation géographique, par s'éloigner de la Francie Occidentale à partir d'Hugues Capet puis de ses successeurs: le francique s'arrête aux Vosges et aux frontières de la Flandre. La cause de ce retrait du francique est essentiellement la division de l'empire carolingien: les seigneurs francs sont, lors des partages, obligés de se fixer dans l'un ou l'autre des nouveaux royaumes alors que jusque là leurs possessions étaient réparties dans tout l'empire. De plus, la langue romane commença peu à peu de s'élever dans l'échelle culturelle et, finalement, elle se généralisera par ce biais, les troubadours puis les trouvères la popularisant. Enfin, y compris, dans les terres germaniques, le francique fut supplanté par la langue dite "souabe" ou "allemande", qui, là aussi, fut la langue généralisée par les Minnesänger et qui devient la langue de la cour des Hohenstaufen (cette langue cèdera elle-même la place à un saxon modifié de francique, à l'époque de Luther, dit langue "francique" ou "saxonne"). Le francique proprement dit, n'a survécu, jusqu'à aujourd'hui encore, que dans les régions frontières entre la francophonie et les terres germaniques, de la Flandre à la Sarre et la forme la plus proche, de nos jours, semble bien être le luxembourgeois. Le francique est, essentiellement, une langue germanique, avec déclinaisons et genres. Il présente, de plus, une très grande liberté écrite pour rendre une même prononciation. A la différence des Anglo-Saxons, les Francs utilisèrent tôt l'alphabet latin pour transcrire leur langue. Dans certains textes carolingiens, on peut trouver certaines majuscules anglo-saxonnes: C, M, Z ainsi que le g minuscule, un b barré qui vaut soit f soit v ou un d barré qui vaut th. - le u du francique se prononce "ou", le uu vaut w (exemple, "uuan" se prononce "wan" (quand)). Un uu suivit d'un u donne donc un mot avec trois u: "antuuuord" est "antword", réponse, ou "uuunta", "wunta", blessure
Website Manager: G. Guichard, site Learning and Knowledge In the Carolingian Times / Erudition et savoir à l'époque carolingienne, http://schoolsempir.6te.net. Page Editor: G. Guichard. last edited: 12/28/2010. contact us at geguicha@outlook.com