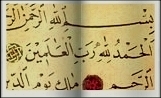
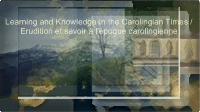
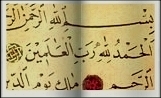 | première sourate du Coran; calligraphie du XXème siècle |
Le monde islamique ne touchait pas, sauf en Espagne, à l'Empire carolingien. Son poids dans l'histoire du Moyen-Orient en tant que principal contributeur à l'histoire de la région à partir de 630, son rôle en tant que centre d'origine théorique des dynasties d'Espagne ou d'Afrique du Nord, ou les bonnes relations que Charlemagne entretint avec Haroun-al-Raschid, en font un centre d'intérêt. Le calife était le "Commandeur des Croyants", un souverain à la fois religieux et politique, le descendant du Prophète
L'histoire de l'Islam commence dans la Péninsule Arabique, à La Mecque, avec Mahomet, le prophète et le fondateur de cette religion nouvelle. Les pistes caravanières qui existent à travers la péninsule arabique depuis la domestication du chameau vers les XII-XIIIème siècles av. J.-C. sont d'abord la route de l'encens venu des confins de l'Arabie heureuse. A partir de notre ère, s ajoutèrent les épices, les perles de l'océan Indien et les soieries des Indes. La route se faisait au long d'oasis et de cités marchandes. Des tribus locales qui assurait la protection des caravanes, les Nabatéens de Pétra puis, à partir du VIe s., les Quraychites de La Mecque sont de telles tribus. Les Nabatéens acceptèrent la tutelle des Perses de Cyrus et profitent de la disparition des royaumes juifs. Sous les Lagides, les descendants d'Alexandre le Grand, ils se livreront au razzias et à la piraterie en mer Rouge pour défendre leurs routes commerciales. Bien qu'ainsi les seuls "barbares" de la région à ne pas être passés sous tutelle grecque, ils en subirent cependant l'influence culturelle. Ensuite, ils paieront tribut à Rome. L'Arabie est, de l'océan Indien aux frontières du Proche-Orient, le pays des tribus arabes dont la prospérité se fonde sur les routes commerciales qu'ils maîtrisent avec les chameaux. Les royaumes nabatéens (Pétra) vers le tournant de l'ère chrétienne puis de Palmyre (jusqu'en 272) constituent les points d'aboutissement de ces routes. Le Nord de la région, ensuite, s'inscrit dans le conflit entre Byzance et les Perses, avec les Ghassanides vassalisés par les premiers et les Lakhmides par les seconds alors que la région de La Mecque devient le nouveau centre commercial de la péninsule. Ainsi, d'un point de vue politique, à l'époque de Mahomet, la région borde les deux grandes puissance de l'époque: l'Empire byzantin chrétien, les Perses sassanides, mazdéens. Des chrétiens et des Juifs étaient présents dans la péninsule arabique du fait de la proximité du mont Sinaï et de Jérusalem. Un tel contexte permettait donc qu'un message monothéiste soit adressé aux populations de culture arabe. Mahomet naquit à La Mecque en 570, quelques semaines après la mort de son père. Arabe, Mahomet était de la tribu des Koreïshites. Il fut élevé par son grand-père qui, selon la coutume, le confia à une nourrice, chez les Bédouins. Lorsqu'il revint, le jeune garçon perdit successivement sa mère et son grand-père. Ce fut son oncle, Abou-Taleb, qui le prit en charge. Mahomet travaillait soit comme berger, soit il accompagnait son oncle lorsque celui-ci menait une caravane en Syrie. Mahomet finit par épouser une riche veuve, Khadidja, dont il était devenu l'agent commercial pour la Syrie. C'est lorsqu'il atteint l'âge de 40 ans que Mahomet commença de prêcher la foi nouvelle. Il rencontra bientôt l'hostilité des habitants de La Mecque car la religion nouvelle à laquelle il appelait remettait en question les revenus que la ville tirait de la Kabaa, ce sanctuaire païen. La tribu des Koreïshites règnait sur La Mecque; il n'étaient pas, à proprement parler, des polythéistes puisqu'ils connaissait un dieu principal entouré de plusieurs petits dieux auxiliaires. Aussi, Mahomet, par sa prédication, ne fit-il qu'obliger à l'adoration du seul dieu principal, Allah (d'où la profession de foi principale des Musulmans: "La illahi illa Allahou...": "Il n'y a pas d'autres dieux que Dieu..."). Ce sont les Arabes sédentaires de la Mecque, au contraire des Arabes nomades pillards, qui fournirent les troupes de Mahomet. Au carrefour des grandes caravanes qui trafiquaient entre Méditerranée et Asie, les Mecquois, courtiers, banquiers, commerçants au long cours, tenaient aussi la Kaaba, édifice cubique contenant la pierre noire, fétiche fondamental. Allah était le "summus Deus" des dieux et déesses de tribus dont les soucis étaient purement temporels. Un peu de spirituel était venu par les Juifs des oasis -tenus pour sorciers- et des différentes variétés de Chrétiens, y compris les ermites de Syrie, toutes personnes que les Arabes regardaient comme des êtres supérieurs du fait de la vertu et de l'intelligence. Des "hanifs" hommes saints des tribus tendant vers la spiritualité annoncèrent le Prophète, qui lui, allait être un hanif convertisseur, dont la rencontre avec des moines chrétiens au cours de ses voyages par caravane fut décisive. Ses visions -selon la tradition des songes des Arabes- vers l'âge de 30 ans, apportées par l'archange Gabriel, le décidèrent à annoncer un nouveau monothéisme. Il rejoignait aussi, par un programme social défendant les pauvres, des prédécesseurs, mélange de sacré et de profane de type politique. Mahomet fut obligé, en 622, de quitter La Mecque pour Médine (qui s'appelait alors Yathrib). Cela eut lieu un an après la mort de Khadidja et celle d'Abu-Taleb qui avait été son protecteur contre les Koreïshites et cela constitue l'"Hégire" (de l'arabe "hijra", "émigration"), qui devait devenir la première année du calendrier musulman. Après une série de batailles menées contre les Koraïshites, la tribu règnante de La Mecque, qui avaient reçu l'aide des tribus juives que Mahomet avait expulsées de Médine, La Mecque, en 630, finit par se rendre à Mahomet, qui venait assiéger la ville à la tête de 20,000 fidèles. Mahomet mourut peu de temps après, en 632. L'installation à Médine transforma Mahomet en homme d'action. D'abord, il unifia les Médinois dont les Juifs qui s'apprêtaient, au milieu des désordres, à y prendre le pouvoir. Cependant ceux-ci raillèrent sa fausse science biblique et ce fut l'origine de la défiance d'avec les "gens du Livre" et, dès lors, l'Islam, via Ismaël ou la Kaaba revendiquée ancien temple d'Abraham, devient seulement national, arabe, "musulman". Dès cette époque par ailleurs, Mahomet le hanif sincère commence de ne l'être plus et il n'est plus que respectueux des traditions arabes: la guerre, la perfidie, les stratagèmes. Enfin, rentré en vainqueur à la Mecque, l'Islam théocentrique se transforme en le "mahométisme" égocentrique: beaucoup de sourates commencent d'être de circonstances à son profit (droit de répudiation, par exemple) -sans compter l'influence d'Omar, un rallé qui sera son successeur. L'Islam est une religion de la force -la preuve en étant que les mystiques musulmans devront emprunter au christianisme pour plus de subtilité- et une religion où l'homme est abandonné au destin, au déterminisme. L'Islam est également très défavorable à aux femmes arabes. Certains n'hésitent pas à conclure que quelques articles de foi permettent aux Arabes de se sauver à bon compte en restant ce qu'ils sont, voluptueux, âpres au gain et ardent à la vengeance. Les hadiths -récits de la vie du Prophère- voire l'"ijtihad" -possibilité de suppléer au Coran- perpétueront le pragmatisme de la dernière péiode mecquoise en ajoutant selon les besoins. Une fois la religion constituée, les éléments principaux de l'Islam furent -et sont- les suivants: "islam" signifie "se soumettre" -les croyants se soumettent à la volonté de Dieu telle que révélée par le Coran. Pour l'Islam, religion monothéiste, la parole de Dieu a été transmise par des prophètes ("rassulun") et Mahomet est le "sceau des prophètes", le dernier d'entre eux. Quelles que puissent être la divergence fondamentale qui allait apparaître par la suite entre sunnites (l'Islam orthodoxe) et chiites (seuls les "imams" (qui sont des guides exemplaires) peuvent révéler le véritable message du Coran), les musulmans s'accordent sur les "cinq piliers de l'Islam", ses bases et sa pratique: la profession de foi qui affirme Allah et son prophète Mahomet, la prière cinq fois par jour, l'impôt sous la forme de l'aumône (la "zakat"), le jeûne pendant le mois de ramadan, le "hadj", le pélerinage à La Mecque qu'on doit accomplir au moins une fois
C'est Abou Bakr, le beau-père de Mahomet, qui devint son premier successeur (632-634), et le premier à porter le titre de "calife" -qui signifie "adjoint" (de Mahomet). Il devint le "commandeur des croyants". L'Islam, la religion nouvelle, était également un moyen d'unifier dans une même communauté religieuse et politique les tribus arabes et les Bédouins nomades. Peu à peu convertis, les Arabes hors de la Mecque, les nomades bédouins, seront employés, selon leur tradition, pour la razzia laquelle ne sera finalement justifiée qu'après coup comme "Jihad", la "guerre sainte". Dans les territoires byzantins de Syrie, la conquête aura même un aspect de panarabisme, les habitants étant de même race que les Arabes. Pour bien des Chrétiens d'Orient, considérés comme hérétiques par Byzance ou refusant une hérésie des empereurs mêmes, l'Islam apparut souvent comme une simple hérésie, un arianisme. De plus, les deux puissances voisines du Nord, au Nord de l'Arabie, l'Empire byzantin et les Sassanides (une dynastie perse) étaient affaiblies et représentaient une proie tentante, se faisant continuellement la guerre et étant en plein déclin. Enfin, la ferveur religieuse et une population en expansion furent les autres raisons de la conquête arabe. Le début ponctuel des conquêtes fut ironiquement déclenché par l'affront que le souverain sassanide, Chosroès II, fit à un Arabe chrétien. Les Arabes et les Bédouins se révoltèrent. Chosroès fut vaincu et fut obligé de se réfugier auprès de l'empereur byzantin, Héraclius. Cette facile victoire fit une grande impression sur les tribus, et la conquête définitive du Moyen-Orient commença en 634. En l'espace remarquable de 8 ans, les armées arabes balayèrent la région, l'Egypte incluse, détruisant les Sassanides et évinçant les Byzantins. Encore 8 années, et les Arabes, en 650, atteignirent les confins de la mer d'Aral. Il n'y avait que 16 ans que les tribus arabes s'étaient mises en marche. Une marche aussi rapide s'explique certainement par le fait que l'art de la guerre des Arabes était adapté aux zones désertiques. Montant des chameaux, ils étaient auto-suffisants et ils n'avaient pas besoin de lignes de ravitaillement. Surgissant du désert, ils frappaient et, en cas d'échec, ils pouvaient s'y enfuir aussi rapidement. Aucune victoire décisive ne put être remportée par les Byzantins ni les Perses qui ne furent pas capables d'organiser des armées suffisamment nombreuses ni de pourvoir en garnisons les fortifications défensives. C'est le second calife, Omar (634-644) qui organisa l'administration des territoires conquis. Les Arabes des conquêtes ne tenaient pas tant à la conversion des peuples conquis qu'au paiment du tribut (et l'inverse pour les peuples conquis, qui tenaient à se convertir pour échapper au tribut)
Faute de territoires à conquérir, la conquête s'arrêta, sauf des initiatives privées en direction de l'Afrique du Nord. Cette pause fut sans doute à l'origine de querelles internes au monde arabe. La religion devint le moyen d'exprimer des mécontentements et les rébellions utilisèrent la religion pour s'exprimer. Cela, de plus, fut certainement lié au fait que ce fut sous le règne du troisième calife, Othman (644-656), que le Coran fut compilé, cette compilation ne s'étant peut-être pas faite sans dissensions. C'est pendant ces années, à la fin des années 660, qu'apparut l'expression la plus célèbre -et la plus importante en termes d'influence sur l'histoire du monde arabe- de telles querelles. Ce fut la fameuse sécession des partisans d'Ali, les Chiites. Le calife Othman fut confronté à l'opposition d'Ali (Ali ibn Abu Talib), le cousin de Mahomet et son beau-fils (il avait épousé Fatima, la fille du Prophète et seule survivante des enfants de celui-ci). Le piétisme d'Ali dénonçait des innovations qui étaient contraires aux directives du Coran. Ali devint le porte-parole des Bédouins qui s'étaient portés volontaires pour servir militairement pendant la conquête de l'Irak et de l'Egypte, et qui étaient mécontents des allocations de terres, de revenus et de pensions. C'étaient les Arabes de la Péninsule qui tiraient tous les fruits de la conquête. Les rebelles finirent par tuer Othman. Ali fut choisi calife. Muhawyah-ibn-Umayya, le gouverneur de Syrie, un parent d'Othman et un membre du lignage koreïshite du Prophète, partit de sa capitale Damas pour rencontrer les forces d'Ali. C'est alors que les plus extrêmes des partisans d'Ali, à leur tour, firent sécession. Ils refusaient l'arbitrage que celui-ci avait cherché alors que le sort des armes semblait lui devenir défavorable. Selon eux, combattre des rebelles devait se faire sans esprit de conciliation et la volonté d'Allah aurait, en définitive, été révélée par l'issue de la bataille. Ces dissidents de la bataille de la plaine de Siffin furent appelés les "Kharidjites" (du verbe "kharaja", partir). D'autre part, malgré un effort pour qu'une solution politique soit trouvée aux désordres, on n'aboutit à rien. Muhawyah fut proclamé calife par certains de ses partisans, et Ali fut assassiné par un Kharidjite en 661 à l'instigation de Muhawyah. Ce dernier, de plus, amena le fils aîné d'Ali, Hassan, à renoncer au califat. Tout cela amena les Chiites à reprendre le combat, alors que Muhawyah était proclamé calife, fondant la première -et célèbre- dynastie du monde arabe, les Omeyades. Les chiites n'acceptent de reconnaître pour chef de la communauté musulmane qu'un membre de la famille de Mahomet. Les Omeyyades, tolérants en matière religieuse, protègent les arts issus de la tradition byzantine, s'appuient sur les cultures locales et développent une civilisation brillante. Ces musulmans furent considérés comme les fidèles orthodoxes de l'Islam, comme les "gens de la Sunna", les "Sunnites". La lutte avec les Chiites reprit quelque peu au cours de l'année 680, quand Yazid Ier, le fils et successeur de Muhawyah, dut écraser avec force un complot mené par Hussein, le second fils d'Ali. Hussein fut finalement tué à Kerbala (Irak actuel), cette même année, par les troupes omeyades. La tombe d'Ali, à Najaf, comme celle d'Hussein, à Kerbala, devinrent les lieux saints du chiisme et le restent encore aujourd'hui. L'autre conséquence du schisme fut que la capitale politique du monde islamique échappa définitivement à la Péninsule Arabique. Celle-ci ne conserva que La Mecque, le site du pélerinage que doivent effectuer tous les musulmans. Ali, dans un premier temps, avait choisit Kufa (actuel Irak) pour capitale. Et Muhawyah fit de Damas la capitale du monde arabe
A Damas, ville acquise à l'hérésie monophysite, ç'avait été Mansour ibn Sarjoun, notable chrétien, grand-père de saint Jean Damascène, qui avait négocia avec les Arabes la reddition de la ville. Son fils, Sarjoun, fut d'intendant et ministre des armées à Moawiya, le premier des Omeyyades. Ce fut au moment où les Omeyyades passèrent à moins de tolérance, sous le calife Walid Ier (705-715), que les élites chrétiennes jouèrent un rôle moins important: les documents administratifs, jusqu'alors rédigés en grec ou en persan, le furent en arabe; l'église St-Jean-Baptiste (qui datait de l'empereur Théodose (379-395)) fut remplacée par la Grande Mosqué des Omeyyades (participèrent cependant encore à la construction des architectes et artisans byzantins qui apportèrent un reste d'influence mais l'influence orientale s'établissait fermement). La légende veut que la mosquée des Omeyyades réunisse chaque vendredi matin (le jour de la prière hebdomadaire) le "conseil des saints invisibles qui régissent secrètement la marche du monde". Les Omeyades en revinrent à la conquête. C'est sous leur règne, parce qu'ils considéraient la Méditerranée comme un élément stratégique contre les Byzantins, que fut lancée la conquête de l'Afrique du Nord et de l'Espagne et que les troupes musulmanes furent arrêtées à Poitiers, en 732, par Charles Martel. La France puis l'Italie, dans la stratégie arabe, ne devaient être qu'une étape pour, par les Balkans, prendre Constantinople à revers. Une marine fut construite dans les chantiers navals de Syrie (que les Byzantins avaient construits), et une armée professionnelle, loyale, ainsi qu'un gouvernement efficace furent mis en place. En 730, le monde arabe sous domination omeyade s'étendait de l'Espagne et du Maroc à l'Ouest, à Samarkand et Kaboul à l'Est, alors que Damas n'avait pas de rivale comme cité. Pendant les 89 ans que la dynastie omeyade dura, la prospérité et le commerce furent florissants et des Juifs et des Chrétiens cultivés -beaucoup d'entre eux des Grecs- furent employés à la cour califale, étudiant et pratiquant la médecine, l'alchimie et la philosophie. Les provinces irakiennes de l'empire, cependant, demeuraient le lieu de rébellions. Les populations, en effet, avaient été déçues que le centre du monde islamique et la capitale passent en Syrie
Finalement, dans les années 740, des rebelles irakiens et iraniens, installés au Khorazan, au nord-est de la Perse, organisèrent à Merv (aujourd'hui Mary, dans l'ex-URSS), un mouvement qui se rallia à Abd-el-Abbas, un descendant de l'oncle du Prophète, parent de la ligne chiite par Hachem, le grand-père de Mahomet. Ses drapeaux étaient noirs. Son appartenance à la ligne chiite fit que les Chiites soutinrent le mouvement. Abou Muslim, à la tête des ces "Hachémites", lança l'attaque contre les Omeyades en 747 et occupa l'Irak. 3 ans plus tard, Abd-el-Abbas, qui n'était pas lui-même un chiite, devint le premier calife d'une nouvelle dynastie, les Abbassides. Les Abbassides sont les tenants d'un islam plus rigoureux mais aussi plus égalitaire à l'égard des convertis non arabes. Les Abbassides, cependant, islamisent en profondeur les régions conquises. Malgré le changement de souverains, et les Abassides proclamant qu'une ère nouvelle de justice et de prospérité allait advenir, le monde musulman continua sur la même ligne. La capitale, cependant, fut transférée à une ville qui fut nouvellement fondée par le deuxième calife abbasside et qui fut developpée par le troisième calife, Al Mansur (754-775). Bagdad, "Madinat-as-Salam", la "ville du Salut", populairement Bagdad, -"le jardin de Dat", un derviche musulman- devait rester la riche et brillante capitale de l'empire arabe pendant 5 siècles, par delà les Abbassides. 100 000 hommes furent employés à la construction de la ville. Bagdad avait été conçue sur un plan circulaire d'un diamètre de 2,6 km et un rempart de 360 tours la ceignait. Une abondante population déborda rapidement ce plan originel, créant un faubourg d'artisans et de commerçants, al-Karh, au Sud et des quartiers résidentiels, à l'Est, entourant le palais du calife, al-Khilafa. En 814, Bagdad était la plus grande ville du monde. Le Khorazan, lui, resta la province favorite des souverains de la dynastie, devenant le véritable centre du pouvoir. Cela eut comme conséquence que Bagdad, sous le règne des sept premiers califes, devint le lieu où se mélangèrent les cultures arabe et persane, atteignant un sommet, qui ne serait plus jamais atteint, de culture islamique. Le calife abasside gouverne avec les centaines de fonctionnaires des "ministères" spécialisés ou "diwan", à la tête desquels se trouve le vizir. L'armée est composée des Turcs, les "Mamelouks" ("possédés"). Le bimétallisme pratiqué par les Abassides tient à leurs mines d'or (Soudan, Nubie) et d'argent (Hindou-Koush). La production consiste surtout en les soieries et les tapis et le commerce se fait avec Byzance (d'où viennent vaisselle précieuse, drogues, esclaves, bijoux), l'Inde (rubis, ébène, éléphants, tigres), l'Afrique (or, esclaves) voire la Scandinavie par les Khazars et les Bulgares. Les Abassides furent en guerre continuelle avec Byzance. La ville, de plus, était un vaste emporium et un noeud de routes commerciales vers l'Asie et la Méditerranée. Bagdad, avec une population d'1 million d'habitants, n'était surpassé en taille que par Byzance (Aix-la-Chapelle, par comparaison, ne comptait que 10000 habitants). Une bonne gestion, par l'irrigation, de l'Euphrate et du Tigre fit que se développa une agriculture hautement productive dans la région. C'est Haroun-al-Raschid (786-806), le fameux calife des Mille et Une Nuits, qui était le calife abbasside à l'époque de Charlemagne. Il apportait déjà un soutien actif aux milieux littéraires, scientifiques et philosophiques, mais ce fut sous son fils, Al Mamoun (813-833), que l'apogée fut atteint. Le calife Haroun-al-Raschid s'installa à Raqqa, ville au bord de l'Euphrate (la ville est toujours une ville de la Syrie actuelle) de 796 à 806; deux palais furent construits sur les lisières de la ville. Raqqa avait été construite par le calife Al Mansur -celui qui avait fondé Bagdad- et dotée, comme elle, d'un plan circulaire; Raqqa devint une étape de la route de la Soie et elle attira des artisans célèbres pour leurs céramiques. Cet apogée du monde islamique ne dura pas. D'une part, dès 756 en Espagne, en 788 au Maroc et en 800 en Tunisie, le pouvoir était passé à des dynasties locales qui avaient rompu avec les Abbassides. D'autre part, l'opposition entre les Chiites d'Iran et l'appartenance sunnite des Abbassides amena un déclin accéléré. Une guerre civile se déclara entre les deux fils d'Haroun-al-Raschid. Lorsqu'Al Mamoun occupa finalement le califat, il décida de maintenir la capitale à Bagdad pour ne pas, cette fois, décevoir les Chiites irakiens. Cela déclencha l'apparition d'une série de dynasties locales en Iran: les Tahirides (821-873), les Soufarides (967-vers 1495) et les Samanides (819-1005). L'Egypte, de son côté, après l'épisode toulounide (868-905) passa aux Fatimides en 969, des chiites ismaéliens venus de l'Ifriqiya, qui devinrent une puissance de taille opposée aux Abassides (ils prendront Damas en 970). En 869-883, un état d'esclaves noirs, le "Zanj", fut fondé dans l'Irak du Sud et l'Iran du sud-ouest. La diversité du monde arabe était certes une force, mais c'était aussi une faiblesse; elle ajoutait d'autres raisons de dissensions à la division fondamentale entre Chiites et Sunnites. Enfin, le déclin des Abbassides fut accentué par le développement de l'influence des Turcs dans le califat arabe. Les Turcs étaient un peuple nomade d'Asie Centrale et de Transoxiane. Les califes abbassides les avaient enrôlés comme guerriers-esclaves (ils sont dits "Mamelouks") au début du IXème siècle. Mais, dès 833, ils avaient réussi à occuper les postes d'officiers libres et, du fait de leur efficacité au combat et que la guerre était leur seule occupation, ils en vinrent rapidement à occuper de hauts postes à la cour. Les commandants turcs, au Xème siècle, n'eurent plus de rivaux arabes ou iraniens et ils furent capables de faire et défaire les califes à leur guise. Le califat fut ainsi réduit à sa seule fonction religieuse, le calife ne servant qu'à légitimer religieusement le pouvoir détenu par les Mamelouks. Bagdad fut cependant encore occupée, de 945 à 1055, par une dynastie iranienne, les Bouahides. Chiites, ils laissèrent aussi les califes -sunnites, de plus- sur le trône. La dynastie abbasside ne retrouva jamais sa splendeur. En 1055, elle passa sous le contrôle des célèbres Seldjoukides, cet autre groupe de Turcs venant du Nord de l'Oxus; sunnites, ils furent bien accueillis à Bagdad. A partir de l'an Mil, tout le Moyen-Orient se fractionne en une multitude de royaumes dirigés par des princes turcs intolérants et constamment en guerre les uns contre les autres. Les califes cependant continuèrent de ne plus avoir qu'un rôle d'apparat. Les Seldjoukides visaient à étendre leur pouvoir en Asie Mineure, à l'encontre de Byzance et en Asie Centrale, leur zone d'origine et ce ne fut que l'un de leurs souverains, Malik Chah qui devint un souverain arabe plus classique, exerçant un contrôle effectif sur l'Est de la Méditerranée et le Nord de la péninsule arabique. La région connut ensuite les Croisades puis l'irruption, à partir de 1221, des hordes mongoles. Le califat abbasside disparut officiellement en 1258, sous les coups du Mongol Ulagu, un des descendants de Gengis Kahn, qui prit Bagdad
Website Manager: G. Guichard, site Learning and Knowledge In the Carolingian Times / Erudition et savoir à l'époque carolingienne, http://schoolsempir.6te.net. Page Editor: G. Guichard. last edited: 10/14/2016. contact us at geguicha@outlook.com