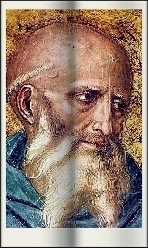
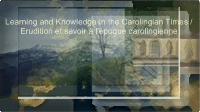
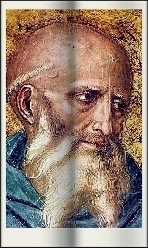 | St Benoît. Fra Angelico, XVème siècle |
Les moines, à l'époque carolingienne, par leur retranchement du monde, leur culture, leurs travaux et domaines agricoles tendent à unir "sacer" (intouchabilité) et "sanctus" (d'Eglise) et insistent sur l'idée de la supériorité de leur vie isolée de celle des laïcs. C'est sur ces bases que l'Eglise pourra lutter contre la violence des temps du déclin carolingien par une pédagogie de la crainte et de la peur. Cette réclusion, cependant, amena la volonté des laïcs de mettre la main sur l'Eglise et, finalement, aux terreurs de l'an Mil, à la volonté des Grands de connaître les secrets du clergé et des recettes du sacré pour faire face aux questions que la détention du pouvoir ne permettait plus d'assumer. D'une façon générale, au cours du Haut-Moyen Age -et spécialement du VIIème au XIème siècle- tant dans l'Empire byzantin que dans les royaumes barbares de l'Ouest, le monachisme devint le seul chemin qui permettait d'atteindre Dieu. Cela influença la structure ecclésiastique et sociétale ainsi que les valeurs de l'époque. Ce monasticisme, cependant, s'était débarassé de la question eschatologique car, en Orient comme en Occident, il était devenu stoïcien et néo-platoniste, se structurant donc sur l'opposition entre le Bien -ou les moines- et le Mal -le monde. Ce qui amena aussi l'opposition entre âme et corps, Ciel et Terre, le visible et l'invisible et, finalement, entre l'élite des moines et des ermites par rapport aux autres clercs et au peuple. Du fait que l'époque fut aussi à un empereur gouvernant l'Est et des monarques gouvernant l'Ouest, l'Orient comme l'Occident furent césaropapistes. Le fait que le gouvernant était l'"évêque du dehors", "roi et prêtre" était aussi compatible avec le monachisme car l'ordre du cloître ne pouvait exister que via des royaumes terrestres ordonnés. L'intime et l'individu devenaient ainsi le royaume des moines alors que l'extériorité et l'eschatologie celui des souverains terrestres. En Occident, la chute de l'Empire romain, par ailleurs, et l'émergence des royaumes barbares firent des évêques les pasteurs et les protecteurs des paysans (de "païens"). Quand l'époque carolingienne fit place aux temps féodaux, les moines clunisiens (qui furent assez byzantins en termes de rituels et de liturgie) avec les évêques réformateurs (avec la Trêve et la Paix de Dieu), essentiellement en France et en Italie, menèrent au Moyen Age classique. Ce qui renouvela comment on envisageait le rôle de l'Eglise: elle n'était plus une réalité séparée du pouvoir temporel -mais en étant cependant nettement distincte- et, en même temps supérieur à lui. Cette évolution n'eut pas lieu en Orient. Le christianisme du Haut-Moyen Age, ainsi, fut monastique et impérial en même temps qu'augustinien. L'intallation de l' Eglise dans l'Empire romain voire la pression fiscale due au développement du dirigisme économique ont mené, dès le début, les moines à se représenter comme fuyant le monde pour mieux suivre les conseils de la vie évangélique. Les moines sont les "amis de Dieu". En Orient malgré des efforts précoces pour placer les moines sous contrôle, ceux-ci conserveront leur indépendance et leur autorité morale voire doctrinale. A partir de Justinien, le monachisme devient un cursus, un état social; les moines reviennent dans le monde. En Occident, le monachisme est plus tardif et prend plus la forme de l'ascétisme, sans séparation du monde. Le monachisme d'Occident est indépendant du monachisme oriental même si celui-ci a exercé une forme de fascination et d'influence. Après une crise rapide -les moines sont mal vus- les moines d'Occident deviennent le "sel de la Terre" et s'accroissent en nombre en même temps que se développent les règles. Les ermites sont également nombreux. Tout cela, après l'épisode ascétique et missionnaire des Irlandais, débouchera sur la Règle, celle de St Benoît. Le monachisme d'Occident commence de trouver sa forme, celle de la clôture, de la règle, qui font du monastère l'image du Royaume, le lieu de la vie angélique. Le déclic se fait à la fin du VIème siècle et, entre 600 et 750, se fondent 200 monastères. Charlemagne se méfiera de ces moines isolés et s'efforcera de les insérer dans l'ordre carolingien (grandes abbayes immunistes et leurs domaines)
On peut dire que les Bénédictins sont les moines de l'Empire en ce sens que c'est à l'époque carolingienne qu'ils s'implantent en Europe définitivement et comme le seul ordre monastique. L'ordre bénédictin est né pendant la première moitié du VIème siècle lorsque St Benoît (vers 480-543) établit un monastère à Subiaco, puis au Mont-Cassin. St Benoît devenait ainsi le fondateur du monachisme occidental. Le monachisme, jusqu'alors, ne s'était développé que dans la partie orientale de l'ex-Empire romain. St Benoît donna une règle à ses moines. C'est la règle bénédictine; la Règle viendrait de la "Règle du Maître", une règle monastique du VIème siècle. Saint Benoît, cependant, la rendit plus spirituelle, plus axée sur la personne et moins étroite. La Règle fait le lien entre le monachisme oriental et les valeurs occidentales
Dans un premier temps, il ne semble pas que St Benoît ait pensé que la règle bénédictine avait vocation à se développer et à s'imposer à d'autres monastères. Subiaco est le monastère fondateur et Benoît est ensuite passé au Mont Cassin d'où l'ordre a vraiment essaimé et la destruction du mont par les Lombards en 580, qui fit que les Bénédictins s'installèrent à Rome près du Latran pendant 140 ans, joua vraisemblablement en leur faveur. Ce furent les circonstances qui firent que l'ordre bénédictin se développa. La règle de St Benoît prit son essor en Europe lors du voyage missionnaire de St Augustin vers l'Angleterre, en 597. Des copies de la règle furent alors essaimées tout le long de la route. De plus, la règle ayant été connue à Lérins, l'abbaye fondamentale de la Gaule du Sud, qui donnait à celle-ci ses évêques, l'essaimage se poursuivit. On doit cependant noter que les monastères des Gaules présentent déjà cette particularité qu'ils n'entendent prendre des règles monastiques que ce qui leur convient, que ce soit celle de St Benoît ou les règles plus anciennes (St Basile, Cassien, St Césaire, etc). L'ordre bénédictin, de cette évangélisation menée en Angleterre, se trouva ainsi, pour longtemps, étroitement associé avec le pays et s'entremêla aux institutions laïques et religieuses, finissant même, finalement, par y supplanter la règle irlandaise. Sur le continent, la règle de St Benoît fut un temps appliquée en concurrence avec la règle plus stricte de St Colomban, ce missionnaire irlandais qui avait fondé de nombreux monastères en Europe continentale. Mais, au IXème siècle, tous les monastères du monde franc étaient passés à St Benoît et les "moines noirs" -du fait de leur vêtement, entièrement noir- étaient devenus les moines de l'Empire. Au VIIIème siècle, Charlemagne pouvait légitimement douter qu'il y ait eu des moines en Occident avant les Bénédictins et, au IXème siècle, la Règle bénédictine était devenue la forme unique de la vie monastique dans l'Europe occidentale, participant à l'évangélisation de tout le continent. L'influence celte ne se maintint, pendant encore un siècle ou deux, qu'en Ecosse, Pays de Galles et Irlande. Les figures les plus importantes de l'Empire -St Boniface, Alcuin, Raban Maur- étaient des Bénédictins ou étaient liés à eux. Charlemagne inséra les monastères bénédictins dans le fonctionnement de l'Empire: enseignement, assistance, responsabilités dans l'administration publique, une ouverture au monde que la majorité des moines accepta
La règle de St Benoît mêlait les tâches du monde avec l'Office divin. C'était une règle modérée. St Benoît avait débarassé le travail de la condition servile qu'il avait dans le monde antique pour en faire le moyen de réhabiliter les hommes. De là que les monastères bénédictins, partout en Europe, étaient devenus des lieux où les terres étaient mises en culture et où l'agriculture était améliorée, des lieux d'érudition et d'enseignement, et des lieux où les moines pratiquaient les arts, les sciences et l'artisanat. Pour concilier l'obligation d'assister à l'office 7 fois par jour et travaux des champs, les Bénédictins utilisèrent l'institution des "convers", des religieux, frères laïcs, employés aux tâches domestiques, en l'occurrence les travaux agricoles éloignés du centre abbatial (on y trouvait une "grange", bâtiment agricole de l'endroit); les moines bénédictins proprement dit, eux, pour ce qui est du travail prôné par la Règle, s'attelaient au scriptorium, au verger ou au jardin des simples et ils étaient, eux, pour la plupart des clercs. Un monastère, à l'époque carolingienne, pouvait être désigné par le terme latin de "locus", "lieu": ainsi, l'abbaye bénédictine de Charlieu, dans la Loire, fondée en 872, tire son nom de "carus locus", "lieu prisé". Il existait 650 monastères à l'époque carolingienne dont 200 étaient des monastères royaux, dont l'abbé appartenait à la famille royale. Les monastères moyens comprenaient aux alentours de 70 moines et les grandes abbayes pouvaient en compter plusieurs centaines
Il n'y avait pas, selon les vues de St Benoît, de liens entre les monastères de l'ordre. Ils n'étaient liés que par la commune application de la règle bénédictine et par une commune obédience à Rome. Les Bénédictins, finalement, furent les seuls moines d'Occident jusqu'au XIème siècle et, jusqu'à nos jours, les Bénédictins ne reconnaîtront jamais d'autre tête que le pape lui-même. Les plus petits monastères sont des prieurés dirigés par un prieur ou une prieure. Avant même Benoît d'Aniane, Charlemagne s'est efforcé d'imposer partout la Règle bénédictine dans les monastères et abbayes du royaume. La pratique à l'époque carolingienne cependant -les plus grandes abbayes créaient des maisons-filles- et l'implication des monastères dans le fonctionnement de l'Empire amena la branche ascétique de l'ordre à la résistance. St Benoît d'Aniane, un Wisigoth, à essayer de réformer l'ordre bénédictin dans le sens d'une plus grande centralisation. Il fut aidé en cela par l'empereur Louis le Pieux. Toutes les abbayes de l'empire devaient être réformées sur le modèle de l'abbaye que St Benoît d'Aniane avait fondée à Aix-la-Chapelle et St Benoît, "abbé impérial", était investi d'une autorité générale sur toutes les abbayes et monastères de l'ordre (assemblée des abbés, Aix-la-Chapelle, 817). La réforme ne fut pas appliquée et cette idée d'une autorité centrale ne survécut pas à St Benoît d'Aniane. Les capitulaires de 817 ne furent considérés que comme des additions à la règle de St Benoît, signe que les monastères septentrionaux, modérés, l'avaient emporté sur la tendance ascétique du Sud. Les biens des monastères furent protégés des abus et les décisions de 817 servirent de référence et il est possible que la conception de St-Gall s'en soit inspirée. Comme St-Gall, l'abbaye carolingienne marque, dans son plan, la solidarité entre le monde monastique et le monde. Une partie de l'abbaye est réservée aux moins alors qu'un ensemble de bâtiments est consacré à l'enseignement, l'accueil des pèlerins et aux soins. Alors que l'abbé dîne avec les hôtes, l'église abbatiale est là où se fait le lien entre monde (les fidèles) et les moines (le choeur). Des bâtiments agricoles et des ateliers permettent la production. L'effort de centralité fut cependant repris en 910, à Cluny, cette fois avec succès. L'abbaye bourguignonne allait insérer l'ordre bénédictin dans le monde féodal. Le système des abbayes-mères préfigure les congrégations qui suivirent, typiques des Bénédictins. Cluny, elle, fut le premier mouvement général d'évolution de l'ordre, qui commença en 910. Cluny, finalement, sur 2 siècles, embrassa 314 monast`res et constitua, non un nouvel ordre, mais une congrégation réformée de celui-ci. Ses vues, cependant, essaimèrent dans la plupart des monastères bénédictins d'Europe, lesquels, à leur tour, aux Xème et XIème siècles, furent la base du mouvement définitif menant aux "congrégations" de l'ordre, via des efforts d'uniformité et de relations privilégiées entre abbayes d'un même royaume (ainsi Lanfranc et les Bénédictins d'Angleterre). Ce ne sera qu'à partir du IVème concile de Latran, en 1215, que chaque abbaye et monastère s'intègreront dans une congrégation territorialisée, rattachée à l'un des royaumes occidentaux. Jusque là certains monastères étaient même restés en-dehors de l'effort clunisien. Une autre caractéristique des Bénédictins est que les abus ou désordres qui ont pu exister ont toujours suscité, de façon récurrente, un effort de restauration de la règle primitive et que, d'autre part, toute réforme n'est jamais venue que de l'intérieur
Website Manager: G. Guichard, site Learning and Knowledge In the Carolingian Times / Erudition et savoir à l'époque carolingienne, http://schoolsempir.6te.net. Page Editor: G. Guichard. last edited: 11/6/2014. contact us at geguicha@outlook.com